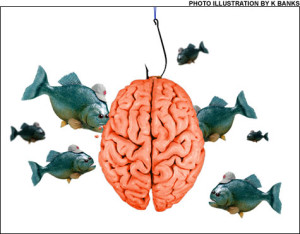Le problème de la publication scientifique et de son violent « capitalisme » fait l’objet de nos enseignements et de nos préoccupations. Nous l’abordons dans les stages pour doctorants ainsi que dans les modules « analyse d’articles » pour professionnels de santé. Richard Monvoisin a d’ailleurs clairement pris position sur le sujet (voir Recherche publique, revues privées, Le monde diplomatique, décembre 2012). Un groupe de chercheurs (CNRS, INRA) emmenés par le biologiste Bruno Moulia ont produit un texte fouillé sur la question, qui étoffera tout enseignement sur le sujet. Nous le reproduisons ici.
Main basse sur la science publique :
le «coût de génie» de l’édition scientifique privée
Imaginez un monde où les chercheurs des établissements publics de recherche et des universités seraient rétribués individuellement en fonction de leur contribution au chiffre d’affaire d’un oligopole de grands groupes privés, et où les moyens humains et financiers affectés à leurs recherches en dépendraient. Projet d’un think-tank ultra-libéral, voire science-fiction pensez-vous ?… ou alors cas particulier de quelques fraudes liées à l’industrie du médicament ? Non, non, regardez bien autour de vous, c’est déjà le cas, dans l’ensemble du monde scientifique (sciences de la nature, médicales, agronomiques…), et ce à l’insu de la grande majorité des gens, et de trop de chercheurs ! Mais une prise de conscience est en train de s’opérer et une bataille s’engage sur tous les continents. Analysons les faits :
Une transformation du processus de production dans l’édition qui a conduit à sa concentration et à la privatisation de la publication par quelques grands groupes
La publication, l’acte par lequel des chercheurs rendent publics et accessibles à leur collègues leurs résultats, est un élément clé du processus de développement de la Science. Le travail des chercheurs y est soumis à une première vérification par des pairs. Cette vérification, si elle n’est pas parfaite (Monvoisin, 20121), permet du moins de modérer le nombre de publications et donc de limiter la dilution de l’information significative –au risque d’un certain conservatisme parfois (Khun, 1952). Si ce travail est jugé significatif par deux pairs spécialistes du domaine (couverts par l’anonymat), ce travail est alors publié c’est-à-dire rendu disponible à l’ensemble de la communauté. La publication est ainsi un élément central de la reconnaissance du travail accompli (et/ou de sa critique) et de la renommée des chercheurs et des équipes, et participe ainsi à la formation de leur « crédit ou capital symbolique » (Bourdieu, 1997). La connaissance est aussi un bien public : un bien qui ne perd pas sa valeur par l’usage d’autrui, mais au contraire qui ne la réalise pleinement que par l’usage que les autres scientifiques en font (Maris, 2006). La publication de cette connaissance, en particulier sa publication écrite, est ainsi le moyen de rendre cette connaissance accessible aux autres chercheurs, aux institutions de recherche, aux journalistes et finalement aux citoyens, permettant son évaluation critique au-delà de la vérification initiale et finalement sa mise en valeur collective. Ainsi la publication est le vecteur principal des idées et des innovations d’un secteur à l’autre. Enfin, la publication est un bien non substituable : si un chercheur a besoin pour son travail de tel article, il ne pourra pas le substituer par un autre article qui serait accessible à un moindre coût (COMETS, 2011).
L’organisation de la publication scientifique, au niveau des chercheurs et de l’édition a donc été un élément important du développement des sciences et un aspect central du mode d’organisation de la production scientifique. Elle s’est faite par la création de journaux scientifiques à comités de lecture. Historiquement, l’édition de ces journaux scientifiques a été essentiellement le fait de structures à but non lucratif : des sociétés savantes et des académies des sciences (le modèle issus des Lumières), des presses universitaires et enfin les presses des grands établissements publics de recherche – CNRS, INRA INSERM …en France (le modèle issu du Conseil National de le Résistance et plus largement de l’après guerre). L’enjeu principal de ces structures était la diffusion de la science, avec un souci de qualité et de reconnaissance.
Or les trente dernières années ont vu une transformation sans précédent des modes de production de l’édition en général, et de l’édition scientifique en particulier (Chartron, 2007). Cette transformation est liée au développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) et à l’informatisation/automatisation des processus éditoriaux et d’imprimerie ; elle culmine désormais dans les bibliothèques virtuelles et autres plateformes « on-line ». Cette évolution, concentrant tous les coûts dans « la première feuille virtuelle » et dans le développement et le maintien de grandes plateformes informatisées, a rendu les tirages limités et donc l’édition des journaux scientifiques rentable via des investissements initiaux conséquents et une concentration du secteur2 . Les petits éditeurs n’ont pas pu suivre. En France par exemple, l’Institut National de la Recherche Agronomique éditait 5 titres dont il a cédé, depuis les années 2000, l’édition, la diffusion et la politique commerciale à des éditeurs privés (Elsevier ,puis Springer)3. Et l’Académie des Sciences française a fait de même pour ses Comptes Rendus (mais pas l’américaine plus avisée ! …).
Ainsi, suite à ce processus de fusion-acquisition massif, l’édition des articles scientifiques est passée majoritairement aux mains d’un oligopole de grands groupes d’édition privés. Cinq grands groupes de presse écrasent désormais le marché : Reeds-Elsevier, Springer, Wolters-Kluwer-Health, Willey-Blackwell, Thomson-Reuter (Chartron, 2010). On peut y ajouter un 6eme, le groupe Nature (du groupe MacMillan, GHPG, un géant du livre). Ces 6 groupes privés concentrent désormais plus de 50 % du total des publications (Mc Guilan and Russel, 2008) sur un marché mondial de l’édition Scientifique Médicale et Technique (SMT) estimé à 21 Milliards de dollars en 20104. Reed Elsevier à lui tout seul concentre 25% du total. C’est un niveau de concentration considérable, généralement considéré comme critique par les autorités européennes de la concurrence car il permet la mise en place de pratiques anticoncurrentielles (Comité IST Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche, rapport 2008)
Ces groupes participent souvent de groupes capitalistes plus larges. Par exemple Thomson Reuter est d’abord un leader mondial de l’information financière. Ce sont aussi des géants de la presse. Ainsi dès sa création en 1993, l’éditeur Reed-Elsevier se situait au troisième rang mondial dans le secteur de la communication, derrière Time Warner et Dun and Bradstreet, et devenait le 3eme groupe anglo-néerlandais après le pétrolier Royal Dutch Shell et le géant de l’alimentaire Unilever (L’économiste, 1992). En 2010, Reed-Elsevier publiait 2000 journaux pour un chiffre d’affaire de 3 Milliards de dollars (The Economist, 2011).
Privatisation de la publication par les 5 Majors: packaging et copyright
Ainsi une part majeure des publications a été privatisée par des sociétés à but lucratifs. Cette captation du produit de la science (la publication) par les marchés se réalise par la cession par les auteurs de leur « copyright »5 au groupe d’édition publiant le journal où ils veulent publier leur article (cette cession est un pré-requis à la publication). Elle se fait au nom des coûts associés à la publication. Or ces coûts se sont fortement réduits du fait que l’essentiel du travail de mise en forme et d’édition est fait à titre gratuit par les scientifiques eux mêmes. Comme le disait Laurette Tuckerman (une chercheuse de l’ESPCI qui a participé aux travaux de la Commission d’Ethique du CNRS sur ce sujet, COMETS, 2011), un équivalent dans la vie de tous les jours pourrait être le suivant : quelqu’un construit totalement sa maison, mais fait appel à un peintre professionnel pour « fignoler » la façade, et… c’est le peintre qui en devient propriétaire via un bail emphytéotique !6 La cession gratuite de copyright requise pour pouvoir publier un article est en effet totale et irrévocable, et court parfois jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur7. Une fois ces droits acquis, le journal peut faire ce qu’il souhaite des éléments contenus dans la publication, sans en référer à l’auteur (COMETS, 2011), à commencer bien sûr par en vendre le droit de reproduction, y compris à l’auteur lui-même s’il souhaite les ré-utiliser ! La connaissance scientifique, bien public s’il en est, s’est trouvée transformée en un produit marchant par le simple ajout d’un packaging (la mise en forme de la revue) et par la chaîne de distribution. Et sans rétribuer aucun producteur !
Un capitalisme de prédation qui fait rêver Wall Street
Le modèle d’affaire des maisons d’éditions scientifique est en effet une première dans l’histoire du capitalisme. Il a fait écrire à un journaliste du Guardian qu’à ses côtés le magnat de la presse aux mille scandales Ruper Murdoch8 passe pour un socialiste humaniste (Monbiot, 2011). Détaillons un peu. Le travail de production des connaissances (travail de laboratoire, collecte et analyse des données, et nombre d’échanges formels ou informels au sein de la communauté scientifique) est réalisé par les chercheurs, les techniciens et les personnels administratifs de la recherche. La rédaction de l’article – travail effectué par un journaliste dans le reste de la presse – est encore réalisé par le chercheur, ainsi que l’essentiel de la mise en forme (grâce aux logiciels performants de traitement de texte scientifique). La validation du contenu est réalisée par d’autres chercheurs, ainsi que le travail éditorial de la revue. Et tout çà à titre gracieux pour les éditeurs, ou plus exactement via une rétribution symbolique (nous y reviendrons). C’est déjà beaucoup plus rentable que dans la presse conventionnelle où il faut payer les journalistes et les composeurs ! Mais il y a mieux (ou pire, c’est selon les points de vue !). Les journaux sont en effet revendus essentiellement aux bibliothèques de ces mêmes organismes publics de recherches ou universités qui ont financé les recherches et le travail de rédaction ; et ce à prix d’or ! Par exemple l’abonnement électronique à la revue « Biochimica et Biophysica Acta9 » coûte environ 25 000 euros /an (Monbiot, 2011). Ainsi les bibliothèques ont vu leurs dépenses liées à l’abonnement aux revues augmenter de 300% en 10 ans (Blogus Operandi , ULB, 2009). Ce poste absorbait en 2010 ; les 2/3 de leur budget (Monbiot, 2011). Ainsi pour chaque publication acquise, l’État, et donc le contribuable, a payé 4 fois le même article !!
1. les institutions payent les chercheurs qui rédigent les articles publiés dans les revues scientifiques ;
2. les institutions payent les scientifiques qui révisent et commentent les articles qui sont soumis à leur expertise (système de peer review) ;
3. les bibliothèques de ces institutions payent aux éditeurs et/ou agences d’abonnement le droit d’accéder aux revues dans lesquelles leurs chercheurs ont publié ;
4. les bibliothèques de ces institutions payent aux éditeurs l’accès perpétuel aux archives électroniques de ces mêmes revues.
A tel point qu’on a parlé de « racket légal » (Montbiot, 2010). Dans des termes plus liés à l’establishment, même la Deutche Bank reconnait que les marges des Majors de l’édition scientifique sont sans commune mesure avec le service fourni (Mc Gigan and Russel, 2008).
En tout cas c’est Jack Pot !! : Des taux de profits à faire pâlir le Nasdaq, et qui durent ! : 36 % pour Elsevier (secteur scientifique et médical) en 1988, 36,4 % en 2000 (Mc Gigan and Russel, 2008) encore 36% en 2010 en pleine crise (Montbiot, 2011) ! Les investisseurs spéculateurs ne s’y trompent pas. Ainsi la firme Morgan Stanley, une des grandes banques d’investissement américaines qui se sont tant illustrées dans la crise des subprimes écrivait à ses investisseurs dès 2002 « la combinaison de son caractère de marché de niche et de la croissance rapide du budget des bibliothèques académiques font du marché de l’édition scientifique le sous secteur de l’industrie des média présentant la croissance la plus rapide de ces 15 dernières années »10 (Gooden et al., 2002). Spéculateurs, fonds de pension, on s’arrache les actions de l’édition scientifique… Quant au chercheur, pigiste-pigeon malgré lui, il constate la diminution des crédits effectivement disponibles pour financer sa recherche (pas son packaging), alors que les gouvernements peuvent communiquer sur un financement accru de la Recherche publique !
1988, 36,4 % en 2000 (Mc Gigan and Russel, 2008) encore 36% en 2010 en pleine crise (Montbiot, 2011) ! Les investisseurs spéculateurs ne s’y trompent pas. Ainsi la firme Morgan Stanley, une des grandes banques d’investissement américaines qui se sont tant illustrées dans la crise des subprimes écrivait à ses investisseurs dès 2002 « la combinaison de son caractère de marché de niche et de la croissance rapide du budget des bibliothèques académiques font du marché de l’édition scientifique le sous secteur de l’industrie des média présentant la croissance la plus rapide de ces 15 dernières années »10 (Gooden et al., 2002). Spéculateurs, fonds de pension, on s’arrache les actions de l’édition scientifique… Quant au chercheur, pigiste-pigeon malgré lui, il constate la diminution des crédits effectivement disponibles pour financer sa recherche (pas son packaging), alors que les gouvernements peuvent communiquer sur un financement accru de la Recherche publique !
La « Science Optimisée par les Marchés » ? Mais c’est la bulle !!!
Si vous êtes chercheur ou simplement contribuable, un néo-libéral vous conseillera sûrement à ce point de récupérer une part de la plus-value de votre travail et/ou de vos impôts en devenant actionnaires de ces sociétés, et en empochant ainsi les dividendes11 ! Et il ajoutera, enthousiaste, que vous participerez en prime à l’optimisation de la recherche par les marchés. Mais justement la science avance, même dans le monde pourtant sous influence des sciences économiques : le modèle démontrant l’optimalité de l’allocation des ressources par le marché (modèle néo-classique) a été remis en cause sur le plan théorique et pratique dès que l’information n’est pas parfaite et qu’il y a des externalités – et la science en est pleine- (travaux du prix « Nobel » Joseph Stiglitz et de ses collaborateurs, voir Stiglitz, 2011). Et la « Grande Récession » mondiale en cours depuis 2008 nous le rappelle tous les jours. Mais on peut aller plus loin : même si on en restait au modèle néo-classique du Marché Optimisateur, ce dernier ne pourrait pas de toute façon s’appliquer à l’édition scientifique ! Comme le remarquait fort justement Morgan & Stanley (Gooden et al., 2002), la demande dans ce domaine est en effet totalement inélastique : les « clients » continuent à acheter quelle que soit l’augmentation des prix, car, comme nous l’avons vu, les publications ne sont pas substituables. Dans ce cas les marchés sont forcément inefficients dans la recherche du « juste prix ». Ils sont essentiellement là dans une position de prédation (on en revient au « racket » (Monbiot, 2009)). Et c’est d’ailleurs bien cette situation qui attire les investisseurs, qui savent bien que les profits juteux sont là où les marchés ne marchent pas (Maris, 2006, Stiglitz, 2011).
On assiste ainsi à une vraie bulle de la publication scientifique. Les journaux se multiplient, car presque tout nouveau journal est rentable et sera acheté. Depuis 1970 le nombre de journaux scientifiques double tous les 20 ans environ (Wake & Mabe, 2009). Quant au nombre de publications scientifiques, il double environ tous les 15 ans (Price, 1963 ; Larsen and von Ins, 2010). Et les prix s’envolent : + 22 à 57 % entre 2004 et 2007 (Rapport du Comité de l’IST, 2008) pour les journaux. En combinant hausse du nombre de journaux et hausse de leur prix, on arrive à une augmentation de +145 % en 6 ans pour l’ensemble des abonnements d’une bibliothèque de premier plan comme celle de l’Université de Harvard (Harvard University, Faculty Avisory Council 2012).
Un contre-argument apporté sur ce point par les sociétés d’éditions et de scientométrie est que l’accroissement du nombre des publications est observé depuis 170012 et qu’il reflète l’augmentation elle aussi exponentielle du nombre de scientifiques. Mais ce n’est pas parce qu’une croissance est exponentielle au début d’un processus qu’il est normal que cette croissance exponentielle se maintienne toujours. Le nombre de publications aurait probablement saturé sans cette bulle (Price, 1963 ; Polanko, 1999). En effet la capacité individuelle de lecture et d’assimilation de chaque chercheur n’augmente pas elle indéfiniment. C’est l’expérience courante de tous les chercheurs qui n’arrivent plus à suivre l’ensemble de la bibliographie, même dans leur spécialité. De même les éditeurs et les relecteurs sont débordés et ont de moins en moins de temps par article, ce qui renforce malgré eux le risque de décision de type « loterie » ou « à la tête du client » (Monvoisin, 2012). On assiste donc à une parcellarisation et une dilution de la connaissance scientifique dans le bruit des publications surabondantes (Bauerlein et al., 2010). Enfin, surabondante uniquement pour ceux qui peuvent payer ! Elle prive les autres, les instituts les moins dotés et les pays en voie de développement de l’accès aux connaissances. Mais l’emballement de la bulle est tel qu’il commence à mettre mal même les institutions les plus riches (ex Harvard University, Faculty Advisory Board, 2012). C’est ce qui a amené de nombreux auteurs à tirer la sonnette d’alarme, et le Comité d’Ethique de la Science du CNRS (COMETS) à émettre en juin 2011 un avis très critique sur cet état de fait (COMETS 2011), suivi plus récemment par le Faculty Advisory Board de l’Université d’Harvard aux USA (Harvard University, Faculty Advisory Board, 2012).
La cotation des journaux à l’Audimat
 Mais avant d’aller plus en avant dans l’analyse des effets de cette marchandisation de la science, il nous faut considérer le dispositif mis en place pour établir une cotation « objective » des dits journaux. C’est un point central. Ce fut le fait d’une de ces mêmes grandes maisons de presse, Thomson Reuters, via sa branche Institut of Science Information/ Web of Knowledge. Fort de son expérience sur les marchés boursiers, Thomson Reuter a en effet organisé un système de cotation annuelle en ligne des journaux, le Journal Citation Reports13. Le principe de cette cotation est tout simplement l’Audimat: combien de fois un article publié dans une revue est-il cité, dans les deux ans qui suivent, par les autres articles publiés dans un pannel de journaux choisi par Thomson Reuter (et dont la représentativité a été discutée (Larson et Von Ins, 2010)). C’est ce qu’on appelle le facteur d’impact de la publication. Ainsi la valeur ajoutée d’une recherche a été réduite par l’action de Thomson Reuter aux points d’audimat de la publication associée. On est ainsi passé d’une considération de qualité du contenu par les acteurs de la recherches (tel article est une avancée majeure) à une mesure automatique du nombre de contenants (combien de lecteurs ont-ils vu cet article, et l’ont cité quelle qu’en soit la raison). On peut rentrer dans la critique détaillée de cette mesure (très biaisée), mais là n’est pas l’essentiel ici. Ce qu’il faut retenir ici c’est que la production scientifique a été ainsi quantifiée sur la base du nombre de publications (i.e. du nombre de contenants –packages- sans référence à la connaissance contenue), tout comme on quantifie n’importe quelle production industrielle ou encore les flux financiers (ceci par le biais de la scientométrie -comme on dit médiamétrie-). Et que cette objectivation et trivialisation de la valeur scientifique a été rendue possible en soumettant l’édition scientifique à la loi de l’Audimat.
Mais avant d’aller plus en avant dans l’analyse des effets de cette marchandisation de la science, il nous faut considérer le dispositif mis en place pour établir une cotation « objective » des dits journaux. C’est un point central. Ce fut le fait d’une de ces mêmes grandes maisons de presse, Thomson Reuters, via sa branche Institut of Science Information/ Web of Knowledge. Fort de son expérience sur les marchés boursiers, Thomson Reuter a en effet organisé un système de cotation annuelle en ligne des journaux, le Journal Citation Reports13. Le principe de cette cotation est tout simplement l’Audimat: combien de fois un article publié dans une revue est-il cité, dans les deux ans qui suivent, par les autres articles publiés dans un pannel de journaux choisi par Thomson Reuter (et dont la représentativité a été discutée (Larson et Von Ins, 2010)). C’est ce qu’on appelle le facteur d’impact de la publication. Ainsi la valeur ajoutée d’une recherche a été réduite par l’action de Thomson Reuter aux points d’audimat de la publication associée. On est ainsi passé d’une considération de qualité du contenu par les acteurs de la recherches (tel article est une avancée majeure) à une mesure automatique du nombre de contenants (combien de lecteurs ont-ils vu cet article, et l’ont cité quelle qu’en soit la raison). On peut rentrer dans la critique détaillée de cette mesure (très biaisée), mais là n’est pas l’essentiel ici. Ce qu’il faut retenir ici c’est que la production scientifique a été ainsi quantifiée sur la base du nombre de publications (i.e. du nombre de contenants –packages- sans référence à la connaissance contenue), tout comme on quantifie n’importe quelle production industrielle ou encore les flux financiers (ceci par le biais de la scientométrie -comme on dit médiamétrie-). Et que cette objectivation et trivialisation de la valeur scientifique a été rendue possible en soumettant l’édition scientifique à la loi de l’Audimat.
La mise en place de cette logistique, et surtout sa mise à disposition de tous et sa promotion ont coûté fort cher, mais là encore Thomson Reuter se trouve en situation de quasi-monopole14. Il peut donc revendre avec fort bénéfice ce service aux journaux et surtout aux instituts de recherches et aux universités. Mais pour les éditeurs privés et les intérêts qui les soutiennent, cela présentait un deuxième retour sur investissement, moins direct, en termes de pouvoir et de prise de contrôle cette fois.
Audimat, Agences de Notation, Classements et Mercato : c’est le modèle TF1 ou PSG… en plus rentable !
L’intérêt de l’Audimat, comme on l’a vu dans le cas des chaines de télévisions privées, c’est qu’il peut se décliner à toutes les échelles, en considérant la part d’audience réalisée. Ainsi c’est l’ensemble des acteurs de la production scientifique (chercheurs, institutions et même journaux) qui se trouve ainsi évaluable individuellement en terme de facteur d’impact cumulé (ou de caractérisations dérivées comme le H facteur évaluant la « valeur de l’homo scientificus »).
Des Agences de Notation (l’AERES en France) construites à l’instar de celles qui existent dans la finance ont alors vu le jour. Ces agences publient (aux frais de l’État) des classements (A+, A, B, C, D) essentiellement fondés sur ces critères. Des agences de financement calquées sur les Banques d’investissement, comme l’ANR en France, ont aussi vu le jour pour faire des crédits à des projets de recherche, sur cette même base. Et toujours sur cette base un « Mercato » mondialisé des scientifiques les mieux classés peut s’organiser entre institutions autonomisées gérées comme des entreprises, sur le mode de celui entre chaines de télévisions ou des clubs de football (il est déjà bien en place dans les pays anglo-saxons et c’est un des enjeux de la loi LRU et de sa suivante actuelle que de l’instaurer en France). Ainsi s’est mis en place un mode de management ultralibéral appelé « publish or perish » (publier ou périr). Cette évolution a été analysée ailleurs beaucoup plus en détail (voir en particulier les livres remarquables d’Isabelle Bruno sur la méthode ouverte de management, (Bruno, 2009) et, de Vincent de Gaulejac (2012), sur les conséquences délétères déjà avérées du management de la recherche et l’article de Philippe Baumard (2012) sur la compétition pour la connaissance dans une perspective de guerre économique) et nous ne le développerons pas. Mais il est utile ici de noter qu’un mode de gouvernance des institutions (corporate management) et de management des ressources humaines néo-libéral a pu s’imposer aux sciences grâce à la transformation des modes de production de l’édition scientifique ; et ceci par la mise en place d’une logistique comparable à celle mise en place pour fluidifier les marchés des capitaux (quoiqu’à moindre échelle), soutenue par des investisseurs et des acteurs comparables (ex : Thomson Reuter, les gouvernements libéraux …). Cet environnement et cette logistique établis, le pouvoir de la rétribution symbolique associé à la publication par une revue de prestige d’un éditeur privé a pu se répandre dans l’ensemble du champ scientifique.
Quand la recherche se gère à la contribution au profit des actionnaires sans débourser un centime de prime: un « coût de génie» !
A la différence de ce qui se passe dans la presse grand public ou même les média télévisuels, la rétribution du producteur primaire (le « travailleur de la recherche scientifique » qu’il soit intellectuel ou manuel15) par les groupes privés d’édition est restée elle essentiellement symbolique, ce qui ne veut pas dire sans pouvoir. En effet, la reconnaissance des équipes de recherche et des individus qui les composent, et l’évaluation de la valeur scientifique de leur production, passe justement par la diffusion et la lecture des publications. Mais, comme nous l’avons vu, grâce au système d’Audimat et d’Agences de Notation et de financement décrit plus haut, la valeur ajoutée d’une recherche a été réduite aux points d’audimat de la publication associée (le facteur d’impact de la publication). Et comme les données d’Audimat sont disponibles et chiffrées (au contraire de la reconnaissance réelle par les pairs) et que tout le système d’évaluation est là pour le légitimer et l’imposer, les chercheurs se sont habitués à considérer le facteur d’impact comme une donnée de première importance, et la gratification symbolique d’avoir un bon facteur d’impact comme suffisante16.
Cette chaîne de valeur symbolique ne le reste pas jusqu’au bout bien sûr : l’actualisation de la valeur en espèces sonnantes et trébuchantes se fait sur le dernier maillon au niveau des sociétés d’éditions lors de la vente des accès aux portefeuilles de journaux (plateformes), puis de la rétribution des actionnaires. Le «coup/coût de génie » de l’édition privée fut d’avoir permis que la valeur marchande (en monnaie réelle dollar, euro…) soit directement corrélée à la cotation du degré de reconnaissance par l’Audimat scientométrique, achevant ainsi l’aliénation de la valeur symbolique de la science en une valeur vénale. Faisant d’une pierre deux coups, l’ensemble de la production est ainsi commandé par une gratification compétitive de chacun des producteurs individuels, permettant au (néo-)Taylorisme de s’imposer en science (comme en attestent la généralisation des diagrammes du principal disciple de Taylor, Gantt, et la gestion des flux tendus que les chercheurs apprennent à connaitre17). Et la boucle est bouclée : les chercheurs sont donc rétribués en terme de crédit symbolique à hauteur directe de leur contribution au chiffre d’affaire des grands groupes privés de l’édition scientifique, via des primes symboliques (qui ne coûtent rien, une sorte de réédition des monnaies de singe des débuts du capitalisme). C’est là la double source du jack pot ! Et aussi de beaucoup d’inquiétude quand on voit ce que la dictature de l’Audimat a pu produire comme effet sur la qualité des contenus dans les médias grand-publics …. On ne s’étonnera guère de la montée des affaires liées à la falsification de données et au plagiat (Monvoisin, 2012 ; Cabut et Larousserie, 2013). Mais une autre conséquence a été moins commentée. Il s’agit de la conséquence sur l’organisation des disciplines scientifiques elle mêmes.
Des disciplines scientifiques à … la discipline des marchés
En terme de marketing, le « marché » des publications est segmenté par l’existence 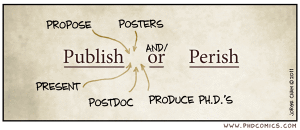 même des disciplines scientifiques (mathématiques, physique, biologie, sociologie, histoire …) et des différents domaines du savoir. La valeur d’impact-audimat des journaux n’a donc de valeur symbolique pour les scientifiques et leurs institutions qu’au sein de ces segments. Les instituts de scientométrie sont donc amenés à établir des regroupements par discipline. Mais le contour même de ces disciplines et domaines sont toujours un peu arbitraires (surtout pour les sous disciplines et domaines). Or les instituts de Scientométrie, en premier lieu Thomson Reuter, se sont arrogé de fait le pouvoir de définir eux-mêmes les contours des domaines, alors que ce travail de différentiation (qui est au cœur de la dynamique de la recherche – Kuhn, 1962- ) était avant aux mains des institutions académiques. En effet comme tous les niveaux institutionnels de la recherche publique sont évalués sur la base des classements d’impact au sein de leur sous-discipline, il suffit que Thomson Reuter -ISI change ses sous-disciplines pour que les équilibres institutionnels soient complètement changés : par exemple, il suffirait d’inclure les « Forestry Sciences » dans les « Plant Sciences », et on verra les meilleurs revues de sciences forestières devenir les derniers de la classe en « Plant-Sciences » pour des raisons liées uniquement à la différence de taille des communautés respectives, déstabilisant ipso facto les départements de recherche en sciences forestières dans le monde entier. Par ailleurs, les pratiques interdisciplinaires, reconnues par beaucoup comme source importante de progrès scientifique, souffrent de cette logique de classement et d’audimat des journaux (voir par exemple Barot et al., 2007 dans le domaine de l’écologie).
même des disciplines scientifiques (mathématiques, physique, biologie, sociologie, histoire …) et des différents domaines du savoir. La valeur d’impact-audimat des journaux n’a donc de valeur symbolique pour les scientifiques et leurs institutions qu’au sein de ces segments. Les instituts de scientométrie sont donc amenés à établir des regroupements par discipline. Mais le contour même de ces disciplines et domaines sont toujours un peu arbitraires (surtout pour les sous disciplines et domaines). Or les instituts de Scientométrie, en premier lieu Thomson Reuter, se sont arrogé de fait le pouvoir de définir eux-mêmes les contours des domaines, alors que ce travail de différentiation (qui est au cœur de la dynamique de la recherche – Kuhn, 1962- ) était avant aux mains des institutions académiques. En effet comme tous les niveaux institutionnels de la recherche publique sont évalués sur la base des classements d’impact au sein de leur sous-discipline, il suffit que Thomson Reuter -ISI change ses sous-disciplines pour que les équilibres institutionnels soient complètement changés : par exemple, il suffirait d’inclure les « Forestry Sciences » dans les « Plant Sciences », et on verra les meilleurs revues de sciences forestières devenir les derniers de la classe en « Plant-Sciences » pour des raisons liées uniquement à la différence de taille des communautés respectives, déstabilisant ipso facto les départements de recherche en sciences forestières dans le monde entier. Par ailleurs, les pratiques interdisciplinaires, reconnues par beaucoup comme source importante de progrès scientifique, souffrent de cette logique de classement et d’audimat des journaux (voir par exemple Barot et al., 2007 dans le domaine de l’écologie).
Une forme d’intégration verticale informelle….sous la pression des fonds d’investissement.
La mise en marché des publications scientifiques décrite jusqu’ici a mis les institutions scientifiques sous l’influence directe de grands groupes capitalistes, dont la logique est nécessairement celle du profit et de la rente. En fait, pour être plus précis, le processus de production scientifique s’est trouvé intégré verticalement (mais de manière informelle) par les sociétés d’éditions. Or ces sociétés d’éditions se trouvent, nous l’avons vu, sur un segment très rentable. Les actionnaires de ces sociétés sont donc ceux des autres sociétés rentables, à savoir des sociétés d’investissement et des fonds de pension (Gooden et al., 2012), avec les mêmes exigences de rentabilité de la rétribution du capital investi par les dividendes, et la même volatilité qu’ailleurs. Par exemple en décembre 2009, Springer Science + Business Media, racheté en 2003 par le fonds d’investissement britannique Cinven et Candover, était de nouveau revendu à deux autres fonds d’investissements, européen et de Singapour (Chartron, 2009). Par ailleurs, la partie du travail qui n’est pas fournie gratuitement par les chercheurs est délocalisée en Inde ou en Chine (Le Strat et al., 2013). Ainsi sans bien s’en rendre compte et tout en restant salariés de leurs institutions, les « travailleurs de la recherche scientifique » se sont retrouvés intégrés dans un secteur concurrentiel, réclamant toujours plus de productivité-rentabilité et la même dynamique de restructuration (fusions, séparations, délocalisation…) que dans les autres secteurs18. Un tel phénomène d’intégration verticale informelle est probablement sans précédent. Il peut être cependant partiellement comparé à deux autres secteurs : celui des artistes face à l’industrie du « disque » et celui des éleveurs industriels. Dans l’industrie de la musique enregistrée, les artistes créateurs voient leur production dépendre de Majors de la musique qui réalisent le packaging de leur production, et l’accès libre à leur production réglementé par des copyrights et protégé par des lois comme la loi Hadopi 2 en France19 , sans être salariés des maisons d’éditions qui les ont « signé ». Ceci s’observe encore plus clairement chez les éleveurs industriels (élevage porcin, volaille) en France. En laissant aux éleveurs une « indépendance » formelle, les firmes de l’agroalimentaire (aliment en amont, viande en aval) ont pu leur laisser croire qu’ils étaient leurs propres maîtres dans leur monde à eux, et leur faire ainsi accepter des conditions de travail et de rémunération qu’il eut été plus difficile d’obtenir d’eux dans le cadre d’une entreprise unifiée (à cause des syndicats, des conventions collectives …)20. Dans le cas des chercheurs, on a pu maintenir ce même sentiment de « travailleur indépendant » (en fait salarié d’une institution scientifique) et de rémunération horaire faible (du moins en France), en y gagnant en plus l’acceptation par le contribuable de payer au moins quatre fois la production scientifique au bénéfice de profits privés. La différence de modèle économique entre artistes et éleveurs de porcs d’un côté, chercheurs de l’autre, c’est que les artistes ne sont pas les seuls consommateurs de leur propre musique, pas plus que les éleveurs ne sont les seuls consommateurs de la viande qu’ils produisent.21
Des dirigeants de haut vol
La séparation entre les institutions de recherches et les maisons d’éditions qui les ont intégrées dans leur système de production permet d’éviter aussi que les chercheurs et le grand public connaissent les vrais dirigeants de l’ensemble. Beaucoup de chercheurs en effet pensent que le domaine de l’édition scientifique est le domaine de respectables institutions séculaires, dédiées à la science, à l’instar de la maison Springer, sans réaliser que la restructuration de l’édition et les enjeux de « l’économie de la connaissance » ont complètement bouleversé la donne. Pour favoriser une prise de conscience de la situation, il est peut être bon de présenter brièvement le pedigree d’un échantillon des cadres dirigeants des majors de l’édition scientifique. En voici donc un échantillon représentatif de cinq d’entre eux :
Sir David Reid, est Non-Executive Director (directeur non-exécutif) de Reed-Elsevier. Il est aussi chairman (président) de Tesco PLC (3eme leader mondial de la grande distribution derrière WallMart et Carrefour22) dont il a été le directeur financier. Il est enfin ambassadeur des affaires du Premier ministre néo-Thatcherien anglais David Cameron. Son collègue Robert Polet a été directeur non exécutif de Philip Morris International et président et chef de direction (chief executive officer) du groupe de luxe Gucci jusqu’à fin 2011. Il a passé 26 ans dans le marketing chez le géant de l’agroalimentaire Unilever où il finit président de la division Crèmes glacées et aliments surgelés (Unilever’s Worldwide Ice Cream and Frozen Foods division). Enfin Cornelis van Lede est dirigeant (Executive Officer) de Koninklijke Philips Electronics NV. M. van Lede a été président et membre du conseil d’administration et chef de la direction d’Akzo Nobel NV (fabricant et distributeur de produits de santé, revêtements et produits chimiques), de 1994 à mai 2003. De 1991 à 1994, M. van Lede a été président de la Confédération de l’industrie et des employeurs néerlandais (VNO) et vice-président de l’Union of Industrial and Employers’ Confédérations de l’Europe (UNICE). Il est président du conseil de surveillance de Heineken NV depuis 2004. Il est président du conseil de surveillance de la banque centrale néerlandaise (…).Il a servi comme membre du Conseil de surveillance de Royal Dutch Airlines KLM. M. van Lede a été membre du Conseil consultatif européen de Jp Morgan Chase & Co. depuis octobre 2005.
Jetons rapidement un œil chez Thompson Reuters maintenant. Parmi ses directeurs nous rencontrons Sir Deryck Maughan qui a été PDG (Chairman and Chief Executive Officer) du Citigroup International et Vice Président du New York Stock Exchange (bourse de New York) de 1996 à 2000. Finissons notre petite visite par le Board of Trustees. Voici Dame Helen Alexander, qui a été (entre autres) directrice générale (Chief Executer) du groupe du journal économique « The Economist » fer de lance de la City, et directrice opérationnelle (managing director) du renseignement stratégique économique (« Economist Intelligence Unit ») entre1993 et 1997. Elle travaille aussi pour la World Wide Web foundation, The Port of London Authority (PLA) et pour Rolls-Royce, et est présidente de la Said Business School à Oxford. Et à ses côtés, voici quelqu’un de plus connu du grand public, le français Pascal Lamy , ancien sherpa de Jacques Delors à la Commission Européenne, et auteur depuis d’une belle carrière qui l’a mené, via le Crédit Lyonnais , à la direction de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC, World Trade Organisation WTO en Globish), bien connue pour son rôle dans la mondialisation néolibérale et la globalisation.
On pourrait continuer (tout est visible et fièrement affiché sur les sites web des firmes correspondantes). Mais on a vu l’essentiel : Marketing, École de Commerce, grande distribution, industries du tabac et de l’alcool, de l’automobile, de l’agro-alimentaire, de la chimie, du médicament, compagnies d’aviations, import-export, groupes financiers, organisations patronales, grands groupes d’investissement spéculatifs, banque mondiale. L’édition scientifique et le contrôle qu’elle offre sur la source de l’économie globalisée de la connaissance attire des seigneurs du capitalisme financier mondial et de la mondialisation23. Et derrière eux, comme nous l’avons vu, la rentabilité de l’édition scientifique attire fonds de pensions et sociétés d’investissement en capital risque.
Une prise de contrôle qui affaiblit la science
Il est important de répéter ici que cette évolution de l’économie des publications scientifiques, et plus généralement de la production scientifique est inefficace (les coûts sont sans lien avec le service rendu, pilotés uniquement par les exigences de la rente servie aux actionnaires). Ainsi le coût par page sur l’ensemble des domaines scientifiques est 5 fois plus élevé chez les éditeurs à but lucratif que chez les éditeurs à but non lucratifs ; alors que le coût par point d’audience (pour prendre les indicateurs même de l’édition privée) est 10 fois plus élevé ! (Tuckerman, 2011). Et surtout cette évolution est totalement intenable économiquement. En effet les accords pluriannuels dits du « Big Deal » signés entre les bibliothèques et les Majors de l’édition scientifique prévoient une augmentation des prix non négociable de 5 à 7 % par an (Comité de l’IST, 2008), pour autant que l’on sache car les accords portant sur l’accès aux collections électronique sont confidentiels (une condition imposée par les Majors de l’édition). Ceci conduit à un doublement des budgets d’achat tous les 14 ans. Le budget annuel d’abonnement aux journaux de l’Université d’Harvard en 2011 atteignait ainsi un total annuel de 3.75 Millions de dollars. A l’Institut National de la Recherche Agronomique français (INRA), le budget « ressources électroniques » en 2013 serait de 2,75 Millions d’€ (dont environ 850 K€ pour le seul Elsevier), ce qui représente un budget de fonctionnement équivalent à celui de l’ensemble des recherches en écologie des forêts et milieux naturels (département EFPA, l’un des 13 départements de cet organisme) ! Enfin pour le consortium Couperin, regroupant l’essentiel des bibliothèques universitaires on évoque des chiffres atteignant 70 Millions d’€ annuels (Cabut et Larousserie, 2013), Dans le contexte de crise économique majeure et de progression lente voire de stagnation des budgets de la recherche publique, les conséquences de cette situation de « racket » s’aggravent et deviennent intenables (Harvard University, Faculty Advisory Board, 2012).
On retrouve ici une caractéristique générale de l’économie de marché : la marchandisation d’un service public s’avère l’opération la plus rentable pour les actionnaires (Maris, 2006). Peu d’investissement, une économie de racket et de bulle artificielle: quand le secteur sera exsangue, les actionnaires iront ailleurs et on laissera à l’État et aux organisations à but non lucratif24, le soin de remonter la science (s’ils le peuvent et le veulent). Et peu importe la perte de bien public pour l’humanité !
Par ailleurs, en science comme ailleurs, le renforcement de la compétition entre les acteurs de la science présente des limites. La science n’a pas eu besoin d’une compétition basée sur l’Audimat pour atteindre des sommets. Notre curiosité, notre volonté très humaine d’améliorer les conditions de notre vie et celles de nos semblables, pimentées par l’émulation de la découverte suffisent largement. La transformation d’une part des chercheurs en gestionnaires de leur portefeuille de publications, avec tous les effets de mode associés qu’illustre le fait de vouloir avoir son papier dans « Nature » renforce encore les tendances non innovantes de la science (Khun, 1958 ;Monvoisin, 2012).
Enfin, la possibilité de contrôle extérieur de la science via les techniques de management à l’Audimat, remet en cause la tendance majeure de la science vers l’autonomie et l’indépendance vis à vis des groupes d’intérêts économiques, et pose de très sérieux problèmes d’éthique (COMETS, 2011).
Ainsi comme on le voit, cette main basse sur la science n’est pas liée uniquement à une quelconque « naïveté » des chercheurs. Elle a été réalisée avec la complicité active et sous la pression des gouvernements néo-libéraux (au sens large), et des think-tanks associés, tout particulièrement en Europe et aux USA (Bruno, 2009)25. Ils y ont vu en effet sur le plan idéologique un des éléments du démantèlement de l’État et des services publics et un mode d’optimisation de la Science selon le dogme du Marché-Grand-Optimisateur, pour ne rien dire des aspects plus prosaïques du lobbying privé des grands groupes de presse ; et aussi, comme nous l’avons vu, la porte ouverte sur un mode efficace (de leur point de vue) de contrôle managérial sur un secteur désormais identifié comme crucial dans des économies néolibérales de la connaissance (Gooden et al, 2002 ; Bruno, 2009). Et cette marchandisation du savoir a impliqué des investissements importants dans la réorganisation de l’édition scientifique et le transfert des techniques issues de la haute finance, sous le pilotage de « seigneurs » du capital financier. Et on n’est pas au bout des innovations dans ce domaine !
Un nouvel avatar : faites bientôt votre Mercato online grâce au Facebook des scientifiques, qu’ils construisent eux même gratuitement !
Une nouvelle innovation a été récemment introduite par Thomson Reuter, qui devrait permettre d’aller encore plus loin dans le contrôle et la modification profonde du fonctionnement de la science. Il s’agit de MyResearcherID26. Au départ, il y a probablement la recherche de solution à un problème technique. En effet la base de données des journaux scientifiques avait été initialement conçue pour la seule cotation des journaux, pas pour celle des chercheurs ni celle des institutions de recherche. En conséquence si les journaux et les articles étaient identifiés de manière non ambigüe (chacun avait un numéro identifiant unique, à l’instar de notre n° de sécurité sociale), ce n’était pas le cas des auteurs et de leurs institutions, qui étaient identifiés uniquement par leur nom, dans un format libre. Ainsi les publications et les points d’audimat attribués à Mr/Ms Smith, Schmidt, Martin ou Zhang peuvent être le fait de très nombreux homonymes différents27. Inversement, d’une publication à l’autre le nom des instituts pouvait changer, parfois CNRS, parfois Centre National de le Recherche Scientifique, parfois avec une virgule, parfois pas…. Et donc on n’arrivait pas à affecter les parts d’Audimats effectives aux différentes entités. Pour les établissements de recherche et les universités, la solution a été imposée par les gouvernements néo-libéraux : à ces établissements de standardiser leur dénomination et de l’imposer à leurs employés, sinon leur part d’Audimat tronquée serait prise en compte lors de leur notation par les Agences, à leur détriment28. Mais au niveau des individus, ce n’était pas possible car même normalisé, Mr Martin restait Mr Martin. Il aurait fallu refondre tout le système et donner à chaque utilisateur un identifiant à l’instar de ce qui se pratique en informatique (login, mot de passe). Entreprise colossale et coûteuse, qui aurait sérieusement grevé les dividendes des actionnaires. Et c’est là qu’intervient l’astuce. On a proposé aux chercheurs de créer leur page web sur le système de Thomson Reuter et ce gratuitement (au début tout du moins). Ainsi ils peuvent bénéficier de la visibilité du système Thomson Reuter. Et dans un souci de « service au consommateur », on leur propose même tous les outils nécessaires pour aller chercher leurs publications et les affecter à leur page MyResearcherID. Mais en créant leur page, ils se voient attribuer un identifiant unique, et ils effectuent ainsi, une fois de plus gratuitement, le lourd travail qui consistent à trier parmi tous les homonymes, les publications qui correspondent à l’individu désormais identifié. Bénéfice considérable pour Thomson Reuter !! Mais surtout un pas de plus dans le management de la Science par les Marchés. Se crée ainsi au niveau mondial et de façon standardisée un équivalent des tableaux palmarès des employés de chez Mc Donald’s, Wall Mart ou Carrefour (en pire car jamais McDo ou Carrefour n’aurait laissé une entreprise extérieure et sans contrat avec eux prendre la main sur les critères de leur palmarès, comme c’est le cas pour les institutions de recherche avec Thomson Reuter). Mais en donnant l’impression aux personnes qu’elles font librement le choix de réaliser leur page MyResearcherID, en les associant à sa réalisation et en leur donnant l’impression d’affirmer leur identité individuelle de chercheur (leur offrant pour cela l’équivalent moderne du miroir magique de la Reine de Blanche Neige) on les implique plus fortement en réduisant leur capacités critiques ; c’est une forme connue de marketing/manipulation (Joule et Beauvois, 2002).
Comme pour FaceBook, la réussite d’un tel système tient au fait qu’un nombre substantiel de personnes s’impliquent rapidement. Il faut en effet que cela crée une norme sociale, que les récalcitrants ou simplement les négligents se voient obligés d’entrer dans le système sous peine d’exclusion sociale avant que la prise de conscience des enjeux cachés du système et sa contestation éventuelle ne prenne de l’ampleur. Pour MyResearcherID la partie est encore ouverte car les institutions renâclent un peu à jouer le jeu, sentant que le cœur du management des personnes pourrait alors leur échapper et que le service pourrait de plus devenir payant. Gageons que les lobbys s’activent en coulisse pour que les gouvernements imposent MyResearcherID comme ils ont imposé l’Impact Factor. Mais au niveau des acteurs même de la recherche, les temps changent.
Des formes de résistances … et une vraie lutte qui s’engage!
En effet une prise de conscience a eu lieu et des formes de résistance s’organisent. Le monde des Bibliothèques des universités et des grands organismes a été le premier à tirer la sonnette d’alarme, publiant des analyses détaillées (ex : Chartron, 2009, Bolgus Operandi, 2009 a,b, Vajou et al., 2010) et commençant même un mouvement de désabonnement. Elles ont vu en effet l’étau des maisons d’éditions Majors se resserrer sur elles et elles ont gouté à l’agressivité de leurs pratiques commerciales lors des négociations dites du « BigDeal » (COMETS, 20111), que certains comparaient à celle de la grande distribution (à juste titre, c’est, nous l’avons vu, la même logique et les mêmes filières de formation pour les cadres). Les chercheurs en informatique, qui avaient été aux premières loges de la lutte sur le logiciel libre, leur ont emboité le pas, bientôt rejoints par les mathématiciens et les physiciens, qui avaient organisé dès les années 90 une alternative efficace sous forme d’archives ouvertes (ou « green open-access », où les chercheurs déposent leurs publications, et viennent chercher celles de leurs collègues via des moteurs de recherche, comme par exemple la fameuse ArXiV). Les journalistes scientifiques, sensibilisés par leur propre expérience des grands groupes de presse et par leur attachement à la science, se sont aussi emparé de l’affaire et l’ont analysée. Et de plus en plus de chercheurs et de conseils, comités, commissions et syndicats se saisissent de ce problème (ex l’ Académie des Sciences29, le Comité d’éthique du CNRS –COMETS 2011- ou le travail de la Commission Recherche de la CGT-INRA sur ce thème30). L’ampleur de cette dénonciation et sa visibilité internationale a augmenté d’un cran avec le mémorandum officiel envoyé par le Faculty Advisory Council de l’Université d’Harvard à tout son corps professoral, affirmant le caractère insoutenable de la situation actuelle (Harvard Univ Faculty Adv. Board 2012, voir aussi l’article de Anne Benjamin du Monde et Jean Perès d’Acrimed).
Le niveau le plus bas de cette résistance est le boycott par les chercheurs des revues des Majors de l’édition. A niveau équivalent, on a souvent la possibilité de préférer une revue restée dans le giron de presses universitaires ou de grands organismes (ex Science plutôt que Nature, PloS31, Plant Physiology ou J Exp Botany plutôt que New Phytologist ou Plant Cell and Environment). Sur ce plan les plateformes des grands éditeurs sont très pratiques pour avoir la liste des revues à éviter pour publier, agir comme référé ou comme éditeur associé (voire pour citer, mais dans ce cas on peut pénaliser l’avancée de la science ..). Mais malheureusement on voit de plus en plus les pratiques de maisons d’éditions universitaires s’aligner sur celles des Majors. De plus, hors d’un mouvement collectif puissant, ce mode d’action est limité, surtout que le mode de management au « publish or perish » (publier ou périr) assure une pression très forte sur les individus. En outre, des communautés entières ont vu leur journaux passer sous contrôle des Majors à leur corps défendant, ou sans réaliser l’enjeu, et il devient très difficile pour des chercheurs de boycotter des journaux qui ont de fait une réelle utilité et qualité scientifique. Un mouvement de boycott est cependant peut être en train de naitre : on assiste en effet ces derniers temps à des appels au boycott. Ainsi deux pétitions sur ce thème circulent en ce moment à l’initiative de mathématiciens, et portées par des médailles Fields32 (Vey, 2012). Cette floraison d’analyses critiques et de prises de positions a même amené certains à s’interroger sur le début d’un « printemps académique » (Agence Science Presse 2013).
 Un niveau plus avancé de résistance est que la communauté scientifique se réapproprie ses moyens de publication. Cela semble techniquement possible, et les réussites les plus prometteuses se situent dans le domaine de l’accès libre (Open Access) 33, avec en particulier la réussite remarquable des journaux PLoS (Public Library of Science) par la bibliothèque nationale des USA et, dans une moindre mesure, de BMC34 pratiquant la licence Creative Commons35 . Encore plus loin du modèle des revues, on trouve le mouvement mondial des archives ouvertes qui a débuté dès 1991 dans le domaine de la physique avec ArΧiv, initiée par Paul Ginsparg, et qui est lui aussi en fort développement dans certaines disciplines. En Europe l’Université de Liège en Belgique a fait office de pionnier avec l’archive ORBI ouverte en 2008, et en France l’équivalent est en place avec HAL (hal.archives-ouvertes.fr). Et un mouvement relancé par l’Initiative dite de Budapest en 2002 autour de l’idée « ce que la recherche publique a financé et produit doit être accessible gratuitement » prend de l’ampleur ( Cabut et Larousserie, 2013). Un appel et une pétition dans ce sens viennent ainsi d’être lancés en mars 2013 par un collectif de chercheurs et de bibliothécaires36.
Un niveau plus avancé de résistance est que la communauté scientifique se réapproprie ses moyens de publication. Cela semble techniquement possible, et les réussites les plus prometteuses se situent dans le domaine de l’accès libre (Open Access) 33, avec en particulier la réussite remarquable des journaux PLoS (Public Library of Science) par la bibliothèque nationale des USA et, dans une moindre mesure, de BMC34 pratiquant la licence Creative Commons35 . Encore plus loin du modèle des revues, on trouve le mouvement mondial des archives ouvertes qui a débuté dès 1991 dans le domaine de la physique avec ArΧiv, initiée par Paul Ginsparg, et qui est lui aussi en fort développement dans certaines disciplines. En Europe l’Université de Liège en Belgique a fait office de pionnier avec l’archive ORBI ouverte en 2008, et en France l’équivalent est en place avec HAL (hal.archives-ouvertes.fr). Et un mouvement relancé par l’Initiative dite de Budapest en 2002 autour de l’idée « ce que la recherche publique a financé et produit doit être accessible gratuitement » prend de l’ampleur ( Cabut et Larousserie, 2013). Un appel et une pétition dans ce sens viennent ainsi d’être lancés en mars 2013 par un collectif de chercheurs et de bibliothécaires36.
Tout ceci inquiète dans les cercles financiers et « The Economist » semble penser que la poule aux œufs d’or a peut-être vécu, ou du moins qu’il sera moins facile à l’avenir de voler les œufs (The Economist, 2010). C’est pourquoi, à l’instar de ce qui se passe dans le domaine de l’édition musicale, les Majors contre-attaquent. On observe ainsi actuellement une forte bataille autour de tentatives législatives visant à déstabiliser la dynamique de l’Open Access et reprendre toute la mise. La dernière de ces tentatives a commencé en décembre 2011 sous la forme du Research Works Act 37, un projet de loi introduit par la Chambre des représentants des Etats-Unis par des élus républicains et démocrates, sous lobbying de l’Association of American Publishers (AAP) et la Copyright Alliance, et autour duquel la bataille a fait rage. La deuxième plus récente a été le procès intenté à Aaron Swartz aux USA (Le Strat et al., 2013, Cassili 2013, Alberganti, 2013,Tellier, 2013). Cet informaticien brillant travaillant à Harvard, et qui avait participé à l’élaboration des flux RSS ou de licence Creative Commons, puis à la lutte sur les projets de lois Sopa et Pipa (les équivalents Etats-Uniens d’Hadopi), avait en 2011 craqué le site d’archivage d’articles scientifiques JSTOR rendant l’accès aux publications (et au savoir qu’elles contiennent) libre et gratuit. Pour ces faits, le procureur des États-Unis Carmen M. Ortiz l’a fait arrêter et l’a accusé de forfaiture, lui faisant encourir une peine pouvant atteindre 35 ans de prison et 1 million de dollars d’amende. Devant cette perspective, Aaron Swartz s’est suicidé, à l’âge de 26 ans38.
Mais plusieurs revers ont aussi été subis par l’oligopole des Majors. Le cas tragique d’Aaron Swartz, et son positionnement au confluent de la culture du net libre et de l’accès libre à la connaissance scientifique a relancé le débat autour de l’économie de la publication scientifique (Alberganti, 2013) et l’a surtout popularisée bien au-delà des cercles académiques (en France, des grands journaux ont couvert l’affaire –ex Le Strat C., S. Guillemarre et O. Michel 2013, Cassili 2013, Alberganti, 2013- et le magazine Télérama a fait ainsi sa couverture sur l’évenement – Tellier, 2013). Sous la pression de ce mouvement d’opinion (très fort aux USA), le Massachuchetts Institute of Technology (MIT) a annoncé une enquête sur cette affaire qu’il a confiée à Hal Abelson, personnalité reconnue du logiciel libre.
Plus largement, sous la pression du monde de la recherche, Elsevier a déclaré le 27 février 2012 qu’il renonçait à son soutien du Research Works Act. Le 17 avril 2012, le mémorandum du conseil consultatif de l’université d’Harvard (dont nous avons déjà parlé) encourage ses 2100 professeurs et chercheurs, à mettre à disposition, librement et en ligne leurs recherches (Harvard Univ Faculty Adv. Board 2012, voir aussi l’article de Anne Benjamin du Monde et Jean Perès d’Acrimed). Par ailleurs, confrontés à la pression venant des milieux académiques et citoyens, aux coûts croissants des budgets des abonnements, mais surtout probablement à un lobbying des entreprises fondant leurs innovations sur les résultats de la recherche et ayant envie d’avoir un accès plus rapide et moins couteux à l’information, les gouvernements de grands pays de recherche sont en train de changer de position. En Grande Bretagne, le 3 mai 2012, le très conservateur et ultralibéral gouvernement anglais a dû aussi faire machine arrière), proposant la création dans les deux ans, d’« une plateforme en ligne permettant à chacun de consulter gratuitement et sans condition toutes les publications subventionnées par l’État britannique ». La réalisation de ce projet serait confiée à Jimmy Wales, un des deux fondateurs de Wikipédia (Jean Perès, 2012). Enfin la Commission Européenne en juillet 201239, et l’administration Obama en février 201340 viennent toutes deux de publier des recommandations allant dans le même sens, tout en recommandant la recherche d’un « équilibre » entre les intérêts de l’innovation et de l’édition (la détermination de cet équilibre étant donc dépendante des rapports de force qui s’établiront autour de cette question). Par ailleurs des juristes proposent que les droits d’auteurs d’une publication liée à un travail réalisé sur fonds publics soient inaccessibles à un éditeur (Le Strat Guillemarre et Michel, 2013). Enfin, au-delà même de la question de l’accès aux publications et du copyright, un large débat de fond continue à monter sur le statut de la connaissance scientifique, celui des chercheurs (en lien avec leur indépendance), insistant sur le caractère délétère du management néolibéral à l’audimat (Couée, 2013).,Il est nécessaire de reconnaitre l’autonomie, l’ universalité et le tempo propre de la recherche (voir par exemple récemment l’appel et pétition « Slow Science »41, mais aussi les travaux de Pierre Bourdieu (1997), Isabelle Bruno (2008) et Vincent de Gaulejac (2012) ainsi que les dénonciations répétées des effets de la politique du chiffre de publications et des « Primes d’Excellences » qui lui sont associées par les syndicats et associations de chercheurs).
Il reste du chemin à parcourir pour construire un système public ou coopératif de publication capable de permettre la diffusion des publications scientifiques au niveau mondial. Il est clair que ce mouvement n’aboutira pas sans une réflexion collective de fond sur la place de la publication : sens du nom du chercheur et du collectif, rôle d’un service public de recherche…. Il est grand temps que la prise de conscience s’effectue et que chacun s’y mette. Vous pouvez déjà y participer en vous intéressant à ces questions, en essayant d’initier des réflexions sur ces thèmes dans vos laboratoires, et de faire aussi pression sur vos institutions et sur le gouvernement pour qu’elles reprennent la main sur les publications qu’elles coéditent avec les Majors et acceptent l’Open Access, et qu’elle revoient leur méthode de management.
On a pris l’ivoire de la Tour ! Des chercheurs dans la rue ?
Cette évolution majeure de l’économie de la science met ainsi les chercheurs, les techniciens et les services d’appui de la recherche au contact direct du capitalisme le plus dur, souvent à leur insu (car peu d’entre eux prennent le temps d’aller visiter les sites web des Majors de l’édition). Mais cette confrontation directe du monde de la recherche avec le rouleau compresseur du capitalisme le plus sauvage fait naître une prise de conscience les faisant sortir de fait de leur tour d’ivoire (Monvoisin, 2012). Face à des budgets réels en baisse du fait du racket des ressources42 et aux absurdités de la gestion de la Recherche par l’Audimat et au seul profit des bénéfices des Majors de l’Edition, les analyses de la situation se multiplient. Les similitudes avec la situation d’autres secteurs qui ont perdu depuis plus longtemps leur protection face à la pression des marchés sont perçues. Nous en avons tracé quelques unes ici : journalistes soumis à l’Audimat et au pouvoir de grands groupes de Presse et de l’orthodoxie néo-libérale, les artistes et le grand public autour des questions de copyright et d’Hadopi, de bien public et des protection des créateurs (le copyright ayant été là aussi dévoyé de son but initial de protection de la création pour être mis au service des gestionnaires de droits).
Les chercheurs ainsi mis à la rue (aux deux sens du terme), on pourrait voire se développer des solidarités revendicatives nouvelles, par exemple avec les journalistes et avec la communauté du logiciel libre. Et plus largement, les chercheurs se trouvent mis à la même enseigne que l’ensemble des personnes soumises au management brutal de la néo-taylorisation des entreprises de services (rejoignant l’expérience plus ancienne des travailleurs de l’industrie). Malgré une connaissance générale de l’histoire des organisations et de la résistance à l’aliénation du travail encore globalement faible dans le monde de la Recherche Scientifique (à l’exception notable des sciences humaines, si visées par les gouvernements néo-libéraux), on peut espérer que cette situation sera salutaire, et permettra à un grand nombre de chercheurs de mettre leur capacité d’analyse et de création au service du mouvement naissant de réappropriation de l’autonomie de la science et de son indépendance vis-à-vis des intérêts privés financiers, et plus largement des biens publics de la connaissance publiques, indûment privatisés. Ce mouvement est en marche, et c’est le moment de l’amplifier.
Le 6 avril 2013 43.
Rédacteurs : Bruno Moulia, Directeur de Recherches Inra (1),
Yves Chilliard, Directeur de Recherches Inra (1) (2),
Yoel Forterre, Directeur de Recherches Cnrs,
Hervé Cochard, Directeur de Recherches, Inra,
Meriem Fournier, ICPEF, Enseignante-Chercheuse AgroParisTech,
Sébastien Fontaine, Chargé de Recherches Inra (1) (2),
Christine Girousse, Ingénieur de Recherches Inra,
Eric Badel, Chargé de Recherches Inra,
Olivier Pouliquen, Directeur de Recherches Cnrs,
Jean Louis Durand, Chargé de Recherches Inra (1) (2).
(1) Membre de la Commission Recherche de la Cgt-Inra, (2) Membre de la Commission Exécutive de la Cgt-Inra
Références
- Agence Science Presse 2013: Le printemps académique http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2012/07/03/printemps-academique
- Alberganti, M, 2013. Economie de la publication scientifique et libre accès: un débat relancé par la mort d’Aaron Swartz. Slate.fr 21/01/2013. http://www.slate.fr/story/67263/suicide-aaron-swartz-economie-publication-scientifique-libre-acces
-
Barot S, Blouin M, Fontaine S, Jouquet P, Lata J-C, et al (2007) A Tale of Four Stories: Soil Ecology, Theory, Evolution and the Publication System. PLoS ONE 2(11): e1248. doi:10.1371/journal.pone.0001248
- Bauerlein M., Gad-el-Hak M., Grody W., McKelvey W. and Stanley W.2010 We Must Stop the Avalanche of Low-Quality Research. The Chronicle of Higher Education : June 13, 2010 http://chronicle.com/article/We-Must-Stop-the-Avalanche-of/65890/
- Baumard P, 2012. Formes de connaissance et compétition. In Harbulot Christian (ed). Manuel d’Intelligence Economique. PUF. 177-188.
- Benjamin A, 2012 Harvard rejoint les universitaires pour un boycott des éditeurs Le Monde.fr | 25.04.2012 http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/04/25/harvard-rejoint-les-universitaires-pour-un-boycott-des-editeurs_1691125_1650684.html
- Casilli A, 2013 Aaron Swartz, le suicidé de l’édition scientifique commerciale , Le Huffington Post, 13/01/2013 http://www.huffingtonpost.fr/antonio-casilli/aaron-swartz-le-suicide-de-ledition-scientifique-commerciale_b_2466175.html
- Couée I, 2013. The economics of creative research EMBO reports 14 :3 222-225 doi :10.1038/embor.2013.11
- Havard University , Faculty Advisory Council, 2012 : Faculty Advisory Council Memorandum on Journal Pricing to Faculty Members in all Schools, Faculties, and Units :Major Periodical Subscriptions Cannot Be Sustained, April 17, 2012 http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k77982&tabgroupid=icb.tabgroup143448
- Pérès J, 2012 : La révolte contre l’oligopole de l’édition scientifique s’intensifie, ACRIMED, 14 mai 2012 http://www.acrimed.org/article3822.html
- Blogus Operandi , 2009 : Le marché de l’édition scientifique est-il compétitif ? Blogus Operandi, le blog des Archives & Bibliothèques de l’Université Libre de Bruxelle 19 Aout 2009 http://blogusoperandi.blogspot.com/2009/08/le-marche-de-ledition-scientifique-est.html
- Blogus Operandi , 2009 : Crise de la publication scientifique : rappel des faits ! Blogus Operandi, le blog des Archives & Bibliothèques de l’Université Libre de Bruxelle 12 Aout 2009 http://blogusoperandi.blogspot.com/2009/08/crise-de-la-publication-scientifique.html
- Bourdieu P 1997. Les usages sociaux de la science : pour une sociologie clinique du champ scientifique. Sciences en Question INRA Editions (Quae) 79 p ISBN 2-7380-0793-7
- Bruno I 2008. « à vos marques®, prêts… cherchez ! » Editions du Croquant 263 p ISBN 978-2-9149-6837-9
- Cabut S, D Larousserie 2013. « Savoirs : Un bien public convoité » (à qui appartient le savoir ?) – Cahier Sciences et Techno Le Monde pp 4-5 n° du 02/03/2013, et édition en ligne http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/02/28/a-qui-appartient-le-savoir_1840797_1650684.html
- Chartron G., 2007. “Evolutions de l’édition scientifique, 15 ans après » in « Enjeux et usages des TIC : Mutations des logiques éditoriales »., Colloque EUTIC 2007, Ed. Gutenberg, Athènes, 2008.
- Chartron G., 2010. Scénarios prospectifs pour l’édition scientifique, Hermès, vol.57, 2010, CNRS Editions, p.123-129 http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/55/87/46/PDF/GC-Hermes.pdf
- COMETS 2011 Avis du COMETS (Comité d éthique de la science du Cnrs) sur « les relations entre chercheurs et maisons d’édition scientifique » http://www.cnrs.fr/fr/organisme/ethique/comets/docs/avis_Relations-chercheurs-maisons-edition.pdf
- Comité IST : Information Scientifique et Technique : Rapport 2008. Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
- Darcos, M, 2011 Le comité d’éthique du CNRS se prononce pour le libre accès et dresse un portrait édifiant du secteur de l’édition scientifique, 22/12/2011 http://blog.homo-numericus.net/article10981.html
- Economiste 1992 Reed-Elsevier : Naissance d’un géant de l’édition. L’économiste N° 47 du 01/10/1992 http://www.leconomiste.com/article/reed-elsevier-naissance-dun-geant-de-ledition#top
- de Gaulejac, V, 2012 La recherche malade du management Editions Quae, collection Sciences en questions, Paris , France, 96 pp. http://www.quae.com/fr/r2044-la-recherche-malade-du-management.html
- Gooden, P, M Owen, S Simon and L Singlehurst, Scientific Publishing: Knowledge is Power, Morgan Stanley, Equity Research Europe, 30 September 2002
- Mc Guigan G. S. and Russel R.D 2008: “The Business of Academic Publishing: A Strategic Analysis of the Academic Journal Publishing Industry and its Impact on the Future of Scholarly Publishing”. Electronic Journal of Academic and Special Librarianship v.9 no.3 http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v09n03/mcguigan_g01.html
- Joule R.V et J.L. Beauvois 2002. Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens. Presses Universitaires de Grenoble ISBN 2 7061 1044 9.
- Kuhn, T.S. 1962 : La structure des révolutions scientifiques. Traduction française : éditions Champs Flammarion, (1983) France, (ISBN 2-08-081115-0). 284 pages, pp.37-38.
- Larsen P.O., • von Ins M. 2010: The rate of growth in scientific publication and the decline in coverage provided by Science Citation Index. Scientometrics (2010) 84:575–603
- Maris, B 2006 « Anti-Manuel d’économie » : Tome 1, les fourmis (2003, ISBN 2-7495-0078-8), Tome 2, les cigales ( 2006, ISBN 2-7495-0629-8) Editions Bréal.
- Monbiot, G, 2011. “Academic Publishers makes Murdoch look like a socialist”. The Guardian 29 August 2011 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/29/academic-publishers-murdoch-socialist
- Monvoisin R 2012 “Recherches publiques, revues privées” Le Monde Diplomatique, n° Décembre 2012 p 27. et édition électronique http://www.monde-diplomatique.fr/2012/12/MONVOISIN/48501
- Price, D. J. de S. 1963. Little science. Big Science. New York: Columbia University Press.
- Stiglitz J 2011 « Le triomphe de la cupidité » Liméac / Babel Actes Sud 513p ISBN 978-2-7427-9504-8
- Le Strat C., S. Guillemarre et O. Michel 2013. « C’est la marchandisation du savoir qui a tué Aaron Swartz » L’Humanité 22-24 février 2013.
- Tuckerman, L, 2011 Les nouveaux enjeux de l’édition scientifique. (présentation au comité d’éthique du Cnrs) http://www.pmmh.espci.fr/~laurette/scipub/COMETS.pdf
- The Economist , May 2011 “Academic publishing: Of goats and headaches ; One of the best media businesses is also one of the most resented” http://www.economist.com/node/18744177
- Vajou M., R. Martinez, S. Chaudiron, 2009 Les Enjeux Économiques de l’Édition Scientifique, Technique et Médicale :Analyses et questions clés « Les Cahiers du numérique 5, 2 : 143-172 »
- Vey T. 2012 : Des scientifiques se rebellent contre le monde de l’édition Le Figaro (edition Web) 21/02 2012-02-22 http://www.lefigaro.fr/sciences/2012/02/21/01008-20120221ARTFIG00547-des-scientifiques-se-rebellent-contre-le-monde-de-l-edition.php
- Ware M & Mabe M 2009, The STM report: “an overview of scientific and scholarly journals publishing”. Mark Ware Consulting http://www.stm-assoc.org/2009_10_13_MWC_STM_Report.pdf
2 c’est la même évolution technologique qui explique la multiplication des revues de plus en plus ciblées dans les linéaires des supermarchés et la possibilité d’avoir pour presque rien un calendrier avec vos photos pour le Nouvel An.
3 Agronomy for Sustainable Development, (anciennement Agronomie), Annals of Forest Science (anciennement Annales des Sciences Forestières), Apidologie, et Dairy Science and Technology (anciennement Le Lait), sont désormais éditées chez Springer,dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, dont le montant avoisinerait 2 millions d’euros, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359772-2010:TEXT:FR:HTML&src=0. Le contrat contient toutefois le droit pour l’Inra de diffuser librement les pdfs des articles sur les sites institutionnels après 12 mois d’embargo.
5 Nous ne traduisons volontairement pas « copyright » en « droit d’auteurs » car les traditions juridiques anglo-saxones et françaises sur la question des droits attachés à l’auteur et à l’œuvre sont différents : pour une introduction très claire de ces différences, voir le site de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques http://www.sacd.fr/Droit-d-auteur-et-copyright.201.0.html , et http://www.sacd.fr/De-1777-a-nos-jours.32.0.html
6 Pour une autre illustration du « business model » de l’édition scientifique basée cette fois sur le monde des jeux vidéo, voir le blog de Scott Aaronson du MIT http://www.scottaaronson.com/writings/journal.pdf
7 Cette pratique du copyright total commence toutefois à se réduire sous la pression des scientifiques à un copyright avec embargo pendant une durée limitée, mais elle reste majoritaire chez les grands éditeurs (Vajou et al. 2009)
8 On se souvient par exemple du scandale récent des écoutes illégales du tabloïde britannique News of the World, qui a défrayé la chronique l’année dernière et mis en lumière les pratiques du groupe Murdoch.
10 Dans sa formulation originale en Globish, cela donne “The niche nature of the market and the rapid growth in the budgets of academic libraries have combined to make scientific publishing the fastest growing sub-sector of the media industry over the last 15 year” D’après le rapport du Comité sur l’IST du Ministère de la Recherche et de l’enseignement supérieur, ces taux de croissance annuelle était de l’ordre de 8%, avec une croissance à 2 chiffres pour la partie édition électronique.
11 C’est ce qu’on appelait naguère la participation, une forme de stock option du pauvre ; car bien sûr le chercheur ou le technicien de la recherche ne pourra s’acheter qu’une très faible partie de ces actions, et restera un petit porteur vis-à-vis des grandes fortunes qui continueront du coup à s’accaparer l’essentiel du bénéfice (en volume)
15 Nous reprenons ici cette dénomination, qui reprend celle d’un syndicat du CNRS, pour désigner tous les salariés qui travaillent dans les institutions de recherches, et vivent de ce travail.
16 D’autant plus que l’obtention de crédits publics pour les projets de recherche auprès des agences de financement est facilitée par une liste fournie de publications, et que le rémunération même des chercheurs peut en dépendre via l’avancement de la carrière (variables selon les systèmes de gestion et d’avancement des chercheurs) voire de … prime d’excellence scientifique (PES) (attention toutefois à ne pas confondre, cette transformation incitative de la reconnaissance symbolique en espèces sonnantes et trébuchantes ne se fait bien sûr pas sur les deniers des sociétés de l’édition, mais bien sur l’argent public)
17 Ainsi l’organisme mis en place par le gouvernement français pour produire des indicateurs sur la recherche (l Observatoire des Sciences et Technique http://www.obs-ost.fr/) reprend le sigle d’OST généralement attaché à l’Organisation Scientifique du Travail, fondée par F. W. Taylor (1856-1915). Connaissant la culture d’histoire politico-économique de nos Enarques, cette coïncidence ne peut être fortuite, et est sûrement une forme de « private joke ».
18 à ceci prêt que le statut de fonctionnaire les protège en partie, mais ce point est en train d’être contourné par la généralisation –dans ce domaine comme partout – des CDD et autres statuts intérimaires
19, notons incidemment qu’Elsevier en tant que lobby, a apporté un fort soutien aux lois dites SOPA (Stop Online Piracy Act) et PIPA (ProtectIP Act) , équivalents états-uniens de nos HADOPI et LOPPS (Pérès, 2012)
20 Les récents scandales sur la viande de cheval ont montré à quel degré d’intégration et de spéculation (« trading ») était arrivé la filière de la viande
21 Dans le cas du monde de la science cette rétribution en monnaie symbolique, peu échangeable hors du champ de la science (sauf à le compenser en allant se vendre sur les grands médias télévisés ou sur le Mercato scientifique), évoque aussi un peu l’étape où les ouvriers des usines étaient payés en billets qui n’avaient cours qu’au sein de l’entreprise, et ne permettait des achats que dans les magasins de la même usine. Mais ici encore le modèle économique de la science est plus subtil, puisque l’achat des publications se fait lui en argent courant. .
23 Nous avons choisi volontairement ici des dirigeants « ordinaires ». On pourrait aussi citer des cas qui ont plus décrié la chronique, comme le cas du sulfureux Robert Maxwell, ancien magnat de la presse anglo-saxonne et partenaire de Bouygue dans la privatisation de TF1, qui avait commencé son ascension avec le groupe d’édition scientifique Pergamon Press, pour devenir un symbole des malversations financières et des relations troubles avec des services secrets. http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Maxwell . Mais le caractère exceptionnel de ces cas affaiblirait le propos, même s’il illustre peut être jusqu’où le système peut dériver.
25 Les plus grands producteurs d’analyse sur la mesure de la production scientifique et les effets de modes de management sont en effet la Commission Européenne, la National Science Fondation américaine, et l’OCDE
27 Situation qui se complique encore pour les chercheuses si éventuellement elles changent de nom lorsqu’elles se marient
28 Tâche qui n’est pas forcément anecdotique quand on sait que le management actuel s’accompagne i) de fréquentes restructurations à tous les niveaux (ex en France la création des instituts au CNRS par le gouvernement Fillon, mais aussi remodelage très rapide du contour des unités de recherches en encore plus des équipes, au rythme de leur notation par les agences ) et ii) de la multiplication des structures englobantes ou de passerelles (ex les Pôles de Recherches et d’Enseignement Supérieurs, Alliances, Agreenium entre l’INRA et le CIRAD …mais aussi les pôles de Compétitivités entre recherche et entreprises privées ….) , l’idée étant de les multiplier pour laisser aux évaluations (et donc comme nous l’avons dit, finalement aux marchés) le soin de faire la sélection et de remodeler ainsi toute l’organisation de le Recherche.
33 L’Open Access est un modèle économique alternatif, dans lequel les frais de publication sont supportés lors de la publication, l’accès étant ensuite gratuit. Cela résout immédiatement la discrimination par la fortune à la connaissance scientifique. Une question cruciale est bien sûr la juste évaluation au prix coutant des frais d’édition et de dissémination. Ce n’est pas une question simple (mais des exemples de réussite existent), et on a vu en tout cas que les Marchés ne pouvaient pas la résoudre. Par contre les Majors de l’édition ont bien vu le danger et elles ont crée un OpenAcess « marron », incorporant leur taux de bénéfice (majorés de leur perspectives de croissance) dans les frais. Donc attention à distinguer l’Open Access équitable de sa contrefaçon mercantile.
Voir aussi Libre accès, et Cabut et Larousserie (2013).
34 l’éditeur BioMedCentral , qui avait fondé son modèle économique sur le paiement par l’auteur et le libre accès au lecteur via les licences Creative Commons a toutefois été racheté récemment par Springer, ce qui démontre que cette bataille reste indécise.
35 Les licences Creative Commons ont été crées à partir du constat selon lequel les lois actuelles sur le copyright étaient un frein à la diffusion de la culture et traduisent en droit l’idée que la propriété intellectuelle est fondamentalement différente de la propriété physique. http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons
42 Notons que même si elle est très importante, la dîme des Majors de l’édition n’est pas le seul détournement de l’argent public destiné à la recherche scientifique par la finance ; les différents « crédits impôts recherches » qui font distribuer l’argent public via des entreprises privées, en leur permettant en sus une optimisation fiscale, ou encore les aspects liés aux brevetage du vivant sont aussi à prendre en considération , mais cela demanderait un travail substantiel et nous renvoyons le lecteur à l’abondante littérature sur ces sujets.