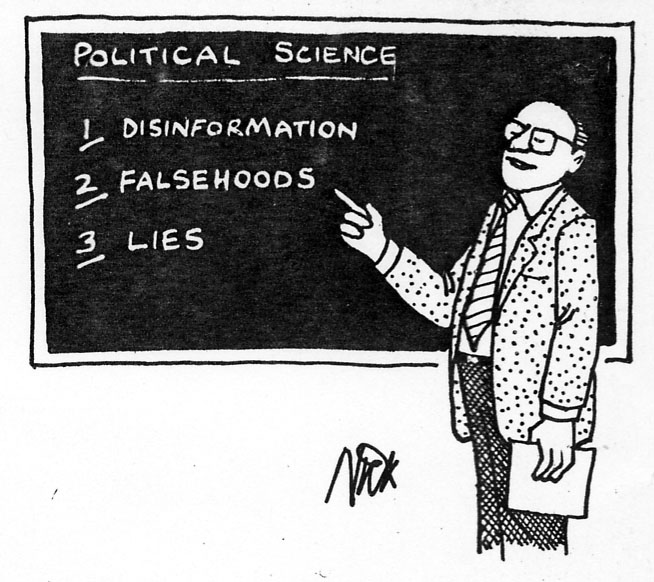À la question d’une journaliste de la BBC demandant jusqu’à quand l’état d’urgence sera prolongé ? Le premier ministre français Manuel Valls répondait le vendredi 22 janvier depuis Davos (Suisse): « Le temps nécessaire. Nous ne pouvons pas vivre tout le temps avec l’état d’urgence. Mais tant que la menace est là, nous pouvons utiliser tous les moyens ». « Cela peut être pour toujours ? » relançait l’intervieweuse. « Jusqu’à ce qu’on puisse, évidemment, en finir avec Daech », déclarait alors le chef du gouvernement. 1
L’état d’urgence se justifierait donc, selon le chef du gouvernement par la réponse à une menace sans précédent et viserait à doter le gouvernement de tous les moyens nécessaires pour y mettre un terme. Convié à discuter de l’efficacité de l’état d’urgence pour répondre au risque d’attentats sur sol français, le CORTECS s’est proposé via notre politiste, Clara Egger, de soumettre à l’épreuve des faits les arguments du gouvernement français.
Dans un exposé de 25 minutes, en trois parties, C. Egger détaille l’histoire de l’utilisation de l’état d’urgence, et apporte des éléments d’évaluation de son efficacité face aux deux types d’ennemis qu’il cible : l’État islamique d’une part et les jeunes radicalisés de l’autre.
Enregistrement effectué lors de la conférence : « État d’urgence : une nécessité », mardi 9 février 2016 à la maison des avocats.
Pour poursuivre la discussion, voici deux autres mini-conférences de C. Egger :