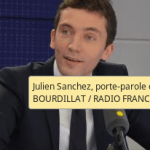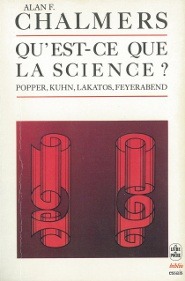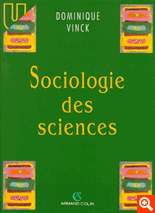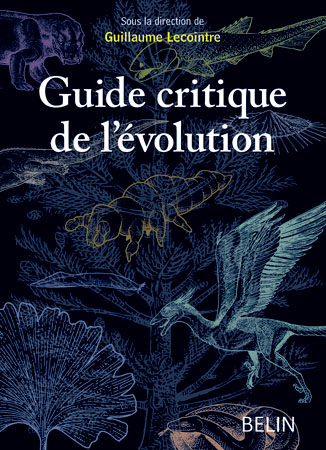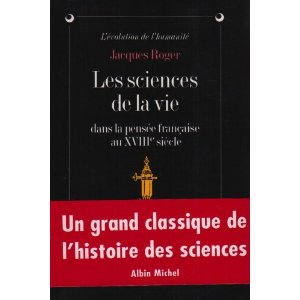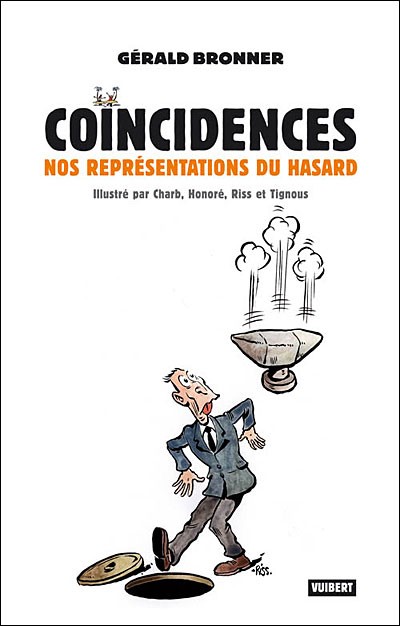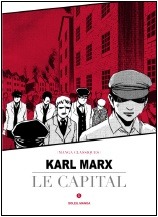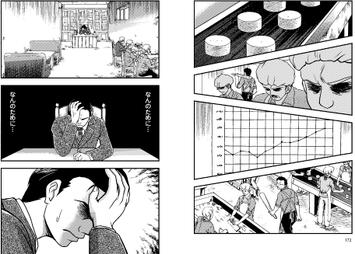Vous êtes kiné praticien depuis quelques-temps, et vous souhaitez vous mettre à jour ? Vous rêviez de faire de la recherche ? Vous êtes fatigué-e de voir un mélange de techniques éprouvées et de techniques fantaisistes dans votre profession ? Vous êtes inquiet-es sur l’avenir des trois années de formation initiale ?
Vous êtes kiné praticien depuis quelques-temps, et vous souhaitez vous mettre à jour ? Vous rêviez de faire de la recherche ? Vous êtes fatigué-e de voir un mélange de techniques éprouvées et de techniques fantaisistes dans votre profession ? Vous êtes inquiet-es sur l’avenir des trois années de formation initiale ?
Venez farfouiller et construire un mémoire de recherche dans le Master 1 MPSI (Mouvement Performance Santé Ingénierie 1ère année) option kinésithérapie de l’Université de Grenoble. Avec l’équipe de J-L. Caillat-Miousse… et quelques morceaux du Cortecs dedans !
Téléchargez la Présentation M1 MPSI option kiné (pdf)
Téléchargez le Dossier de demande de recevabilité VAE (pdf)
Public concerné : Kinésithérapeutes diplômés (D.E. ou diplôme d’exercice étranger).
Pré-requis : 3 années d’activité professionnelle ; présentation d’un projet de poursuite d’études ; connaissances bases en anglais et informatique nécessaires
Diplôme : Maîtrise Sport, Santé, Société option kinésithérapie (60 ECTS)
Niveau visé : Master 1 du Master « Mouvement, Performance, Santé, Ingénierie » parcours Recherche ou Professionnel
Contenu : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET ETUDE DES PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES EN KINESITHERAPIE (80h)
Objectif : Se préparer à concevoir, réaliser, rédiger (rapport de recherche) et communiquer sur un travail de recherche (poster, soutenance et publication scientifique)
Kinésithérapie, recherche documentaire et rédaction scientifique 7h
Etude des productions scientifiques en kinésithérapie 8h
Kinésithérapie et méthodologie 20h
Kinésithérapie, éthique et recherche 2h
Kinésithérapie et informatique (traitement de texte, tableur, …) 8h
Kinésithérapie et statistiques appliquées 20h
Kinésithérapie et anglais scientifique 5h
Suivi individualisé du travail de recherche 10h
TRAVAUX PERSONNELS ENCADRES (220h)
Objectif : Concevoir, réaliser et communiquer un travail de recherche
(article scientifique et/ou communication orale en congrès)
Stage (laboratoire de recherche ou terrain de recherche clinique) et rédaction d’un mémoire, sous la
direction d’un kinésithérapeute enseignant et d’un responsable du laboratoire ou du stage de recherche
clinique.
(LES AUTRES UE DE L’OPTION KINESITHERAPIE SONT VALIDEES PAR LA VAE )
Durée prévisible 300h (80h enseignement et 220h travail personnel encadré).
Regroupements 4 séminaires de 3 jours :
- 21-22-23 novembre 2011
- 9-10-11janvier 2012
- 20-21-22février 2012
- 26-27-28 mars 2012 à Grenoble
Validation contrôle continu (40%) et production et soutenance d’un mémoire de maîtrise (60%)
Renseignements d’ordre pédagogique
Jean-Louis CAILLAT-MIOUSSE (Enseignant Responsable)
UFR STAPS Ecole de Kinésithérapie (CHU de Grenoble) 19 A avenue de Kimberley 38130 Echirolles Tel : 04 76 76 89 76 ou sinon 04 76 76 52 56 Fax : 04 76 76 59 18
Formalités d’inscription
Bernard GENOUD, Service Formation Continue Université Joseph Fourier BP 53 38041 GRENOBLE CEDEX 9 Tel : 04 56 52 03 30 Fax 04 56 52 03 32
NB : les candidats sont invités à prendre contact avec le responsable formation continue de leur établissement
employeur s’ils souhaitent une prise en charge de cette formation.
Coût 2600 € (formation continue VAE et droits universitaires)
Poursuite d’études masters 2 professionnels ou masters 2 recherche (si stage en laboratoire de recherche), 3ème cycle universitaire : doctorats


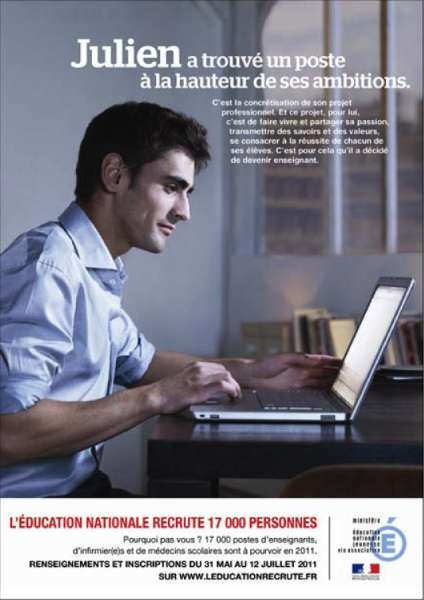
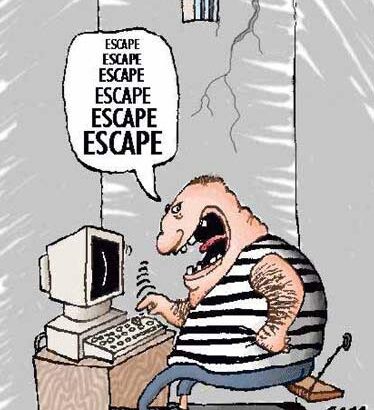
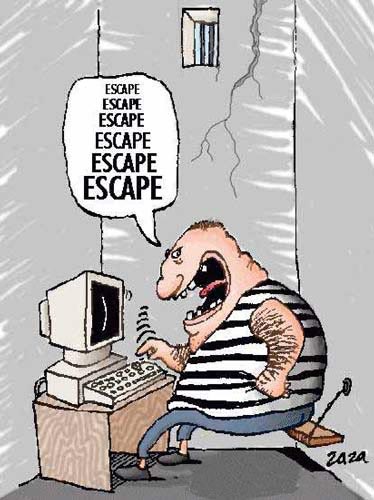

 En couverture du fameux mensuel Enfant magazine de janvier 2011 : « L’ostéopathie, ça marche aussi pour les petits »
En couverture du fameux mensuel Enfant magazine de janvier 2011 : « L’ostéopathie, ça marche aussi pour les petits »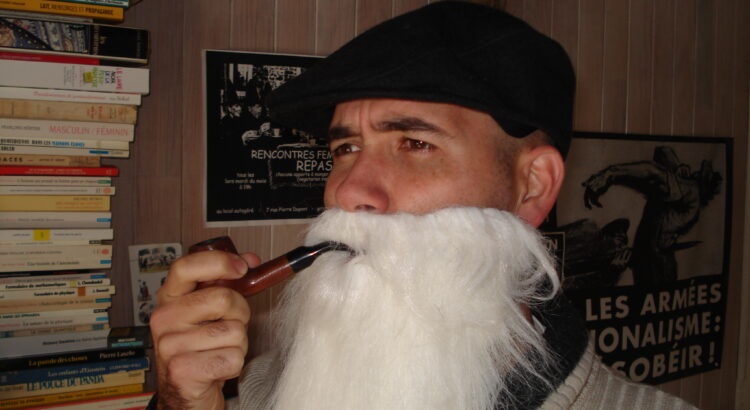

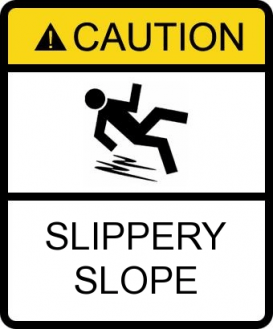



 chaine LCP le 23 juin 2011 (trouvaille de Christophe Michel, alias Chrismich, de Chambéry, youtuber d
chaine LCP le 23 juin 2011 (trouvaille de Christophe Michel, alias Chrismich, de Chambéry, youtuber d