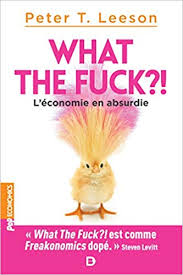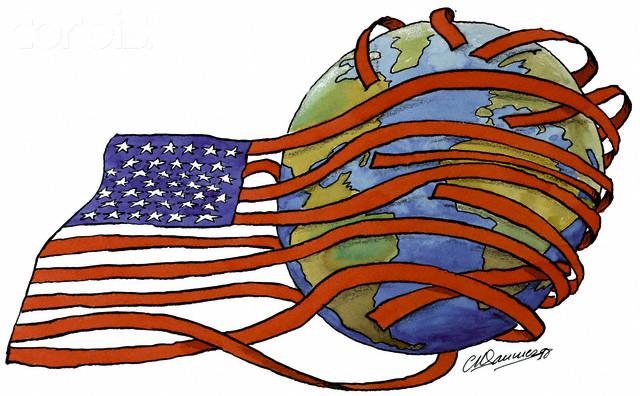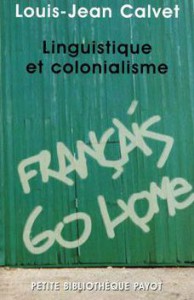En pensée critique, on connaisait l’effet Mathieu 1 faisant référence à la moindre recognition (notamment en science) de ceux qui parte avec un capital de départ (matériel, social ou culturel) moins élévé. On doit à Margaret Rossiter, historienne des sciences états-unienne, une variante, l’effet Matilda, un clin d’oeil à la suffragiste, libre-penseuse, abolitionniste, Matilda J. Cage, une des premières à dénoncer l’absence des femmes dans les récits historiques et scientifiques.
Parmi les sans-droits et sans-noms des oubliettes de l’histoire des sciences, une écrasante majorité a en commun d’être de genre féminin. Les femmes scientifiques sont moins reconnues de leur vivant, notamment en raison de leur statut plus précaire et subordonné. 2 Leur contribution est aussi invisibilisée dans les récits scientifiques, par paresse – on s’attarde uniquement sur les figures, principalement masculines, déjà connues -, inertie ou biais sexiste.
Margaret W. Rossiter revient sur certaines de ces figures oubliées dans son article sur l’effet Matilda 3. Une des premières connues est Trota, une médecin de l’Italie du douzième siècle, qui documenta et traita, de manière inédite, des pathologies féminines. Son nom devint connu par l’action de son époux et de son fils, tous deux médecins également. Un moine, chargé de rédiger un traité sur la médecine au Moyen-Age, décida toutefois qu’une telle contribution ne pouvait être que le fait d’un homme et donna à son nom la forme latine masculine. Une erreur qui la fit passer, en tant qu’homme, à la prospérité. Il faudra attendre le vingtième siècle pour que cette erreur soit réctifiée par l’historien de la médecine allemand Karl Sudhoff, qui, au passage, dégrada sa qualification au rang d’assistante sage-femme, un statut qui retira toute mention à ses découvertes dans les ouvrages scientifiques postérieurs.

Plus proche de nous, Frieda S. Robscheit-Robbins, doctoresse en médecine allemande experte du traitement de l’anémie, fut privée du Prix Nobel en 1934 au profit de son co-auteur. L’histoire retient par contre, sa « présence »et ses coiffes toujours élégantes 4. Si les femmes non- mariées sont d’office non reconnues, les travaux et découvertes des femmes mariées à d’autres scientifiques reviennent, quasi systématiquement, à leur conjoint, même dans les cas, nombreux, où leur contribution excède celle de leur partenaire masculin.
En qualifiant cette stratégie d’invisibilisation systématique, l’effet Matilda invite à accroître notre vigilance et à considérer, au moment de se pencher sur l’histoire des découvertes scientifiques, qu’il est fort probable que derrière chaque grand homme se cache non seulement une multitude de collaborateurs oubliés mais aussi un grand nombre de femmes.
Si vous faites partie de celles et ceux qui ont contribué à réparer cette injustice en effectuant des recherches sur des femmes scientifiques oubliées? Contactez nous !