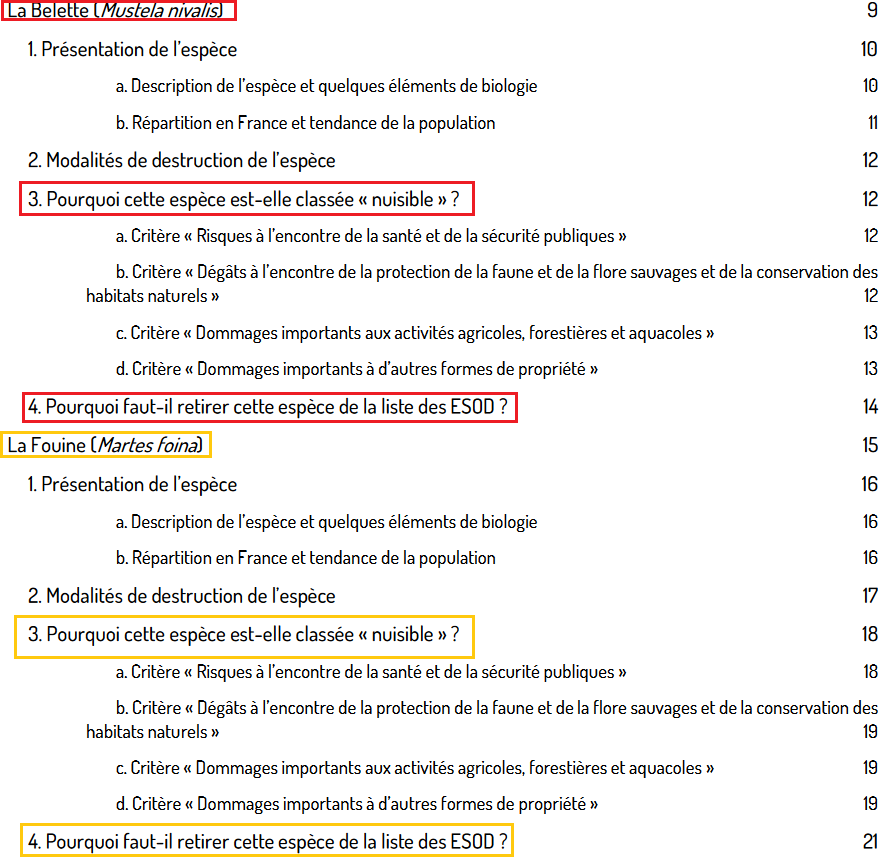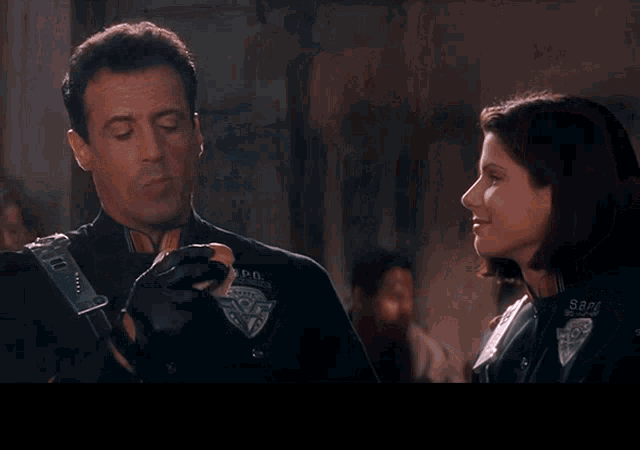Au mois d’Avril Nicolas et David ont présenté aux Rencontres de l’esprit critique plusieurs ateliers participatifs. L’un d’entre eux proposait de débattre sur les liens entre science et politique. On revient sur ces ateliers dans cet autre article.
Par souci d’honnêteté (et probablement parce que nous aimons à croire que notre avis a de la valeur) nous proposons ici quelques pistes de réflexion et notre posture sur ce sujet-là.
[toc]
Introduction
Nous avions déjà nos avis avant ces ateliers et les échanges qui y ont eu lieu ont permis d’en formaliser certains, d’en nuancer d’autres, d’en découvrir encore d’autres.
Avant de commencer prenons un peu de recul et notons que suivant le groupe sociopolitique auquel l’on s’identifie, une des deux réponses est plus cool que l’autre. Et tout sceptique que nous sommes (ou que nous souhaiterions être), il est clair que nous sommes influencés par le fait que « la science est politique » puisse être un refrain répété et valorisé au sein de nos bulles sociales. Tâchons, tant bien que mal, de s’en extraire et d’essayer de comprendre ce que cela peut vouloir dire !
Comme cela a été bien identifié au cours des ateliers, se positionner sur l’affirmation « la science est politique » dépend énormément de ce que l’on met derrière les différents termes. Ainsi, que l’on entende « Le résultat d’une expérience scientifique dépend de l’orientation politique du gouvernement » ou que l’on entende « L’activité scientifique interfère avec la vie publique », la réponse ne sera pas la même ! Une bonne manière de discuter la question est donc, dans un premier temps, de débroussailler le sens que l’on donne à cette phrase.
Pour aller plus loin nous vous proposons ci-dessous quelques pistes de réflexions sur ce sujet-là.
[David] Les différentes acceptions du mot science
Évidemment, ce qui suit n’a pas pour prétention de trancher le débat. Il s’agit uniquement de ce qui nous semblait important à exposer.
Au cours des différents débats et discussions des ateliers, c’est surtout le mot « science » qui a été questionné, chacun·e y allant de son interprétation (à raison, sa polysémie laissant le champ libre !). Le mot « politique » a un peu été laissé de côté, en tout cas nous n’avons pas eu accès aux sens que les participant·es y mettaient.
Personnellement la définition du CNRTL me convient très bien :
Politique : qui a rapport à la société organisée.
C’est assez large pour inclure (presque ?) tout ce qu’on considérerait politique intuitivement. Et même ce qu’on ne considérerait pas politique au premier abord. C’est un reproche courant de ce type de définition super inclusive : « Si tout est politique, alors plus rien ne l’est ». Il se pourrait bien que tout soit politique, mais ça n’empêche pas d’imaginer ce qui pourrait ne pas l’être. (Cela dit, l’emprise des sociétés organisées sur la planète est telle que même l’ermite le plus reclus respire un air pollué et ingère des micro-plastiques.)
Pour ce qui est du sens du mot « science », repassons une couche avec 5 acceptions courantes (détaillées dans cet autre article du Cortecs) :
– La démarche
– Les connaissances
– La communauté vue du dehors
– La communauté vue du dedans
– Le complexe technopolitique
Ces 5 sens sont pratiques pour mieux comprendre de quoi on parle quand on dit « science », mais gardons en tête qu’ils sont indissociables. Les humains composant la communauté se cachent derrière la construction de la démarche et son application ; les connaissances sont manipulées par la communauté, influencent la démarche ; et le complexe technopolitique est toujours présent, étant à la fois la structure sociale dans laquelle s’inscrit la communauté et le produit des connaissances, techniques et technologies issues de l’application de la démarche.
Vous suivez toujours ?
Voyons maintenant de quelle manière chacun de ces sens est lié à la politique.
S’il semble évident que le complexe technopolitique est lié à la politique (c’est dans le nom), ça ne l’est peut-être pas pour tous les aspects qu’il recouvre.
Je suis d’ailleurs insatisfait de la définition donnée par le lien ci-dessus, qui parle de sciences appliquées, technologies et de la genèse socio-politique des axes de recherche.
Tel que je le comprends, il faudrait diviser cette catégorie pour y mettre d’un côté les technologies (grille-pain, centrale nucléaire, pesticides, etc.) et les sciences appliquées (réseau électrique, fission nucléaire, agriculture, etc.) et de l’autre les institutions qui soutiennent ces sciences/technologies/communautés ainsi que leurs traductions politiques (les institutions ne sont pas forcément à mettre dans la communauté, par exemple si on parle d’un ministère).
Cette précision étant faite, pourquoi par exemple, des technologies « banales » seraient politiques ?
Votre grille-pain est politique à deux niveaux :
- Il est inscrit dans un système technique : conçu, produit avec divers matériaux transformés, assemblé, vendu, raccordé au réseau électrique. Son existence suppose une société complexe et très organisée, avec des niveaux hiérarchiques et de la centralisation. Il est très peu plausible qu’un grille-pain soit produit dans une société anarchiste.
- Sa conception induit des usages, qui à leur tour induisent une organisation sociale. Il est absolument faux de dire que « les outils sont neutres, tout dépend de ce qu’on en fait ». Justement, ce qu’on en fait est prédéfini à l’avance. Vous pouvez essayer de détourner l’usage d’un grille-pain, vous n’irez pas loin.
Ces usages contraints mènent donc à agir d’une certaine façon, ce qui forme une pratique sociale à partir d’une certaine échelle. Un exemple caricatural mais très illustratif est celui du smartphone : cet outil a modelé de façon très visible les sociétés qui l’ont adopté. Il est devenu un cadre de pensée. À chaque situation son app’ dédiée.
La communauté vue du dehors ou du dedans, ce sont des humains. Je ne pense pas avoir besoin de développer longuement sur ce qui les relie à la politique. Même la chercheuse la plus indépendante ou le prof le moins investi dans l’organisation de son université ont suivi un parcours de vie qui ne doit rien au hasard, ont des motivations à étudier leur sujet, et impactent la société par leurs activités.
Les connaissances sont politiques par le fait même d’exister… ou de ne pas exister. Produire de la connaissance, c’est coûteux. La production dépend donc de l’intérêt que vouent les scientifiques à étudier un sujet, de l’argent, du temps et des moyens matériels qu’on y consacrera, et du risque qu’on perçoit à étudier le sujet.
Diffuser la connaissance, c’est coûteux également. Là aussi, intérêt, argent, temps, moyens, matériels, tout ça, tout ça.
Enfin, il serait naïf de penser que « tout dépend de ce qu’on en fait ». Tel un outil, la connaissance induit mécaniquement certaines conséquences. On ne peut pas simplement affirmer que « ce qui est ne dit rien de ce qui doit être » (voir le paragraphe ci-après) : on apprend que telle substance utilisée à grande échelle est en fait méga-cancérigène, et on ne va rien faire ?
Enfin, la sacro-sainte démarche ! (ou LA méthode, comme on l’entend parfois, ce qui est déjà trop souvent.)
Premio, elle n’est pas un concept abstrait fonctionnant en autonomie. Il lui faut des humains pour l’imaginer et l’appliquer. La démarche a bien été construite et elle continue de l’être, parce qu’on le veut bien.
Deuzio, la démarche est elle aussi un outil. Et vous savez ce qu’on dit à propos des outils : « tout dépend de ce qu’on en fait ». Non, encore une fois, un outil est fait pour quelque chose. La démarche scientifique, ainsi que toutes les méthodes particulières, sont des outils qui prescrivent des usages.
Troizio, le simple fait de vouloir faire de la science (entendre : appliquer la démarche) est un objectif qui, arbitraire qu’il est, peut se questionner. Une société peut décider des champs qu’elle laisse explorer à la science et de ce qu’elle organise autour de la science. Va-t-on étudier la production de nourriture ? le système de communications ? les moyens de donner des soins ? Ou rien de tout ça ?
Peut-être voyons-nous la démarche scientifique comme un exemple pur de neutralité parce que notre société lui a laissé le champ libre et qu’elle étudie (presque ?) tout. Mais elle n’a pas ce caractère hégémonique partout sur Terre, et ne l’a pas toujours eu chez nous.
Étudier scientifiquement un sujet a inévitablement des conséquences. C’est a minima un changement de point de vue qui s’opère sur l’objet, a fortiori un changement d’organisation sociale.
[Nicolas] « Ce qui est n’implique pas ce qui doit être » et ce que cela implique réellement…
Imaginez un gâteau aux fraises. Avec beaucoup de chantilly et des fraises bien rouge. Aussi succulent soit-il, l’existence de ce gâteau n’implique pas automatiquement qu’il doive être mangé. Encore faut-il qu’il y ait quelques personnes autour de la table, qu’elles aient faim (ou qu’elles soient suffisamment gourmandes), qu’elles ne soit pas allergiques aux fraises, éventuellement encore qu’il y ait un couteau pour couper ou des assiettes pour servir.
L’existence en soi n’implique aucune action, encore faut-il qu’il y ait un désir, un besoin !
C’est à peu près cela que l’on entend quand on dit que le descriptif n’implique pas le prescriptif, que la science est amorale1, ou comme le dit la guillotine de Hume : « Ce qui est n’implique pas ce qui doit être« .
Ce principe peut se justifier d’un point de vue logique assez fondamental. Un argument dont la conclusion contient un « il faut » ou un « doit » – une conclusion prescriptive – ne peut pas découler de prémisses uniquement descriptives. Il faudra au moins une prémisse prescriptive. Prenons quelques exemples :
- « Le nucléaire est l’énergie la plus bas carbone » n’implique pas directement « Il faut promouvoir le nucléaire ». Il faudrait y ajouter une prémisse prescriptive du type « Il faut promouvoir l’énergie la plus bas carbone ».
- « Il y a des différences biologiques entre certains groupes humains » n’implique pas directement « Il faut traiter différemment les différents groupes humains ». Il faudrait y ajouter une prémisse prescriptive du type « Les différences biologiques doivent servir de critères pour accorder des droits ».
- « L’homéopathie n’a pas d’efficacité propre » n’implique pas directement « Personne ne devrait prendre d’homéopathie ». Il faudrait y ajouter une prémisse du type « Personne ne devrait utiliser de thérapies sans efficacité propre ».
Une fois que l’on prend le temps d’exprimer la prémisse prescriptive manquante on se rend compte que la conclusion n’est pas forcément si évidente. Pourtant il arrive bien souvent que l’on cette tendance à sauter directement à la conclusion. Il est donc fondamental de marteler ce principe de la guillotine de Hume dans l’exercice de notre pensée critique.
Ce principe semble (au moins a priori) dissocier le scientifique (descriptif) du politique (prescriptif) et ce dans les deux sens :
- Ce qui doit être n’a pas à se plier à ce qui est : Par exemple, si l’on constate une inégalité (économique, biologique, sociale, …), cela n’implique pas qu’il faille préserver cette inégalité2. Cette première erreur est à rapprocher de l’appel à la nature ou de l’appel à la tradition.
- Ce qui est n’a pas à se plier à ce qui doit être : Par exemple, si l’on promeut l’utilisation d’une certaine pratique, cela ne doit pas influencer notre perception de celle-ci.
Cette erreur est à rapprochée du raisonnement motivé.
Le principe de la guillotine de Hume est souvent celui que défendent celles et ceux qui disent que la science n’est pas politique. Et je suis absolument d’accord avec ce point de vue. Mais il ne faut pas se tromper sur la portée réelle de ce principe ! Examinons quelques éléments pour comprendre ce que ne dit pas la guillotine de Hume et pourquoi il est trompeur de croire qu’elle énonce que la science n’est pas politique.
La frontière entre descriptif et prescriptif
Si d’un point de vue logique il semble qu’il y a une limite claire entre un énoncé descriptif et un énoncé prescriptif, une fois exprimé dans un langage naturel, dans un contexte humain la limite devient assez floue.
Considérons ces trois affirmations :
- « Les moustiques sont le plus important groupe de vecteurs d’agents pathogènes transmissibles à l’être humain, dont des zoonoses »
- « Il faut éliminer certaines espèces de moustiques »
- « Certaines espèces de moustiques sont un danger pour l’humanité ».
La première est clairement descriptive et la deuxième est clairement prescriptive. Mais comment classer la troisième ? Elle semble descriptive, mais l’utilisation du terme « danger » implique une certaine préférence. On peut imaginer que, suivant le cadre dans lequel elle est énoncée, elle pourrait sous-entendre automatiquement certaines prescriptions.
Autre exemple : si je dis « les antivax sont des cons », il semble s’agir d’un énoncé descriptif duquel on ne peut conclure sur ce qu’il faudrait faire sans une autre prémisse prescriptive comme « il ne faut pas être con » ou « il ne faut pas parler avec des cons » ou « il faut lutter contre les cons ». Oui sauf que, ces prémisses-là sont plus ou moins sous-entendues. Elles sont, d’une certaine manière, contenues dans le terme « con » et dans les connotations qui lui sont associées. Nos normes sociales, notre bagage culturel, notre langage forment un package de départ contenant un certain nombre de valeurs prescriptive sous-entendues.
Ainsi « Manger X peut causer la mort » peut directement se traduire par « Il ne faut pas manger X » puisque la prémisse prescriptive « Il ne faut pas manger ce qui peut causer la mort » est sous-entendue.
De la même manière les affirmations « Il y a des différences biologiques entre certains groupes humains » ou « Les antivax sont des cons » qui n’impliquent absolument rien d’un point de vue strictement logique risquent suivant le contexte d’énonciation d’interagir avec d’autres prémisses cachées. C’est pour cela que l’on devrait être extrêmement prudent avec ce genre d’affirmation et le cadre dans lequel on les utilise.
Il existerait donc des énoncés purement prescriptif, d’autres purement descriptifs et encore d’autres qui paraissent descriptifs mais sous-entendent un certain nombre d’éléments prescriptifs. Mais où fixer la limite ? À vrai dire, il semble peut-être plus parcimonieux de considérer que tout énoncé charrie par sa formulation et le contexte dans lequel il est utilisé une certaine charge prescriptive plus ou moins forte.
L’importance du contexte d’énonciation
Précisons ici, que ces prémisses cachées dépendent du contexte dans lequel est énoncée l’affirmation puisque l’interprétation dépend des valeurs du groupe auquel on s’adresse. Des connaissances sur la biodiversité partagées dans une classe de CM1, sur un plateau de télévision ou à un congrès de Valeurs actuelles 3 ne rencontreront probablement pas les mêmes valeurs.
Un fait scientifique pouvant être formulé de différentes manières et dans différents contextes, le choix de ces derniers n’aura pas les mêmes conséquences. Ainsi « Certaines espèces de moustiques sont un danger pour l’humanité », « Les moustiques tuent près d’un million d’humains par an » ou « Une minorité d’espèce de moustique sont des vecteurs d’agents pathogènes pouvant être mortels pour l’homme » qui relèvent tous trois d’un même fait scientifique, n’ont pas le même impact.
Lien avec la non-neutralité de la technique
A fortiori, ce qui est vrai pour une production descriptive est vrai pour une production matérielle. Comme l’a montré David plus haut, un grille-pain implique une certaine utilisation de ce grille-pain ou une guillotine implique une certaine utilisation de cette guillotine (oui c’est méta). On vient de voir que le même raisonnement s’applique vis-à-vis d’un énoncé scientifique.
L’un comme l’autre ne sont pas neutres, ou alors dans une acception du mot « neutre » qui me parait assez peu satisfaisante.
Ainsi, si vous posez le gâteau sur la table il y a de très fortes probabilités que celui-ci soit rapidement englouti ! Parce que si l’ontologie du gâteau n’implique pas la gourmandise des enfants, on peut estimer que celle-ci est fortement attendue.
Ce que coupe réellement la guillotine de Hume

Attention ! Ce développement ne disqualifie pas la guillotine de Hume, bien au contraire ! Elle est un principe indispensable mais il faut en connaître la portée. La distinction descriptive/prescriptive est tout-à-fait pertinente dans une analyse critique d’un sujet, mais dès lors qu’un énoncé, aussi descriptif soit-il, est plongé dans un contexte humain il faut s’attendre à ce que celui-ci interagisse avec un certain nombre de sous-entendus prescriptifs. Cela devrait nous pousser à prêter une attention particulière aux normes sociales dominantes, à nos propres valeurs morales et à comment des énoncés scientifiques peuvent les conforter ou les bousculer !
[David] Science et engagement
À travers les petites et grandes histoires, nous avons eu une grande diversité de rôle de la science dans l’engagement.
Il semble même que toutes les acceptions courantes de « sciences » aient été représentées : certain·es nous parlaient de leur amour de la méthodologie d’une discipline scientifique, d’autres de discussions avec des scientifiques amateurs, avec des logiciens du quotidien, ou avec des professeurs, d’autres encore de leur découverte de savoirs scientifiques, ou d’autres enfin des impacts de technologies dans leur vie, voire de décisions politiques dans lesquelles le lien avec la science devenait lointain (et c’est tant mieux, l’important dans l’atelier était de livrer des pépites tant qu’on ne dérivait pas trop).
Sans prétendre qu’il soit possible de faire de la sociologie ni de la psychologie à partir de cet exercice, je souhaitais partager un constat qui m’inquiète.
Il semble qu’au sein du mouvement « sceptique », une conception de la science comme d’un objet neutre et potentiellement détaché de la société soit courante et défendue. Il est curieux que des personnes qui réfléchissent à l’irrationalité humaine semblent supposer que lorsqu’ils énoncent un fait celui-ci sera traité par un agent sans vécu, sans désir, sans préférence.
Je m’inquiète de ce que cela peut produire comme engagement.
Si vous consommez du contenu « sceptique », vous avez certainement déjà entendu des affirmations comme « la méthode scientifique est objective », « la science est auto-correctrice », « la science est le moins pire des moyens pour approcher de la vérité ». Voire même des variantes de « Si l’humanité s’éteignait demain et laissait la place à de nouveau êtres intelligents, ils développeraient la même science que nous » : si l’expérience de pensée est intéressante, la conclusion proposée dénote d’une vision positiviste et réaliste naïve (à savoir : les sciences avancent inexorablement dans la même direction et découvrent la vérité du monde).
Cette conception de la science élude les débats autour du réalisme ainsi que la part socialement construite des sciences.
Que faire d’une telle conception de la science dans le champ politique ?
Le risque, en concevant la science comme un objet autonome et lui conférant un certain pouvoir d’énonciation du réel, est de perdre le sentiment de légitimité à s’insurger contre des productions issues des sciences, de n’agir qu’à condition d’avoir des données scientifiques, et de cesser d’envisager exercer un contrôle sur la science, comme on le ferait pour d’autres objets sociaux.
Je ne dis pas qu’il faut tout casser, mais comprendre que la production scientifique (sous forme de discours, de techniques et de technologie) est omniprésente et forme un cadre de pensée qu’on ne questionne plus (comme le fait d’utiliser un grille-pain branché sur un réseau électrique, pour reprendre un exemple concret).
Je ne dis pas qu’il faut balancer toute rationalité et agir spontanément par intuition, mais que la science si avancée soit-elle ne pourra jamais répondre à certaines questions, qui resteront à jamais des décisions humaines et arbitraires (les questions morales notamment). Certaines raisons de croire resteront à jamais non épistémiques.
Je ne dis pas qu’il faut soumettre les découvertes au vote à main levée, mais considérer que la science est pleinement insérée (dans toutes ses acceptions) dans une société et que celle-ci a toute légitimité à décider de l’utilité qu’elle en aura : que veut-on étudier ? Sous quel angle ? Dans quel but ? Avec quels moyens ? Que ne veut-on pas étudier ?
Certains sceptiques (ils ne sont pas les seuls cela dit) ne comprennent pas que l’on puisse défendre des positions « radicales » et le rôle qu’ils donnent à la science dans l’engagement y est peut-être pour quelque chose. Les positions radicales ne sont pas « anti-science », elles tentent de comprendre un sujet au-delà des aspects étudiés par les sciences, d’envisager sa complexité, ce qui est largement compatible avec la prise en compte des données scientifiques à disposition.
Une idée radicale ne découle donc pas forcément d’un raisonnement « scientifique », en tout cas pas entièrement, et elle assume ce fait.
Ainsi il me semble qu’une conception de la science telle que décrite ci-avant entrave certaines formes d’engagement, pour en favoriser d’autres qui négligent des aspects axiologiques et politiques et finalement réduisent le réel tout en pensant détenir la moins pire des méthodes pour le capter.
[Nicolas] Existe-t-il une partie de l’activité scientifique qui soit dépourvue d’arbitraire ?
À travers les différents éléments que nous avons entrecroisés ici, l’idée était de montrer que l’activité scientifique (y compris de vulgarisation scientifique) interfère avec le reste de la vie publique :
- En amont du travail scientifique : dans les directions de recherche et dans le choix des développements techniques ; dans la structure des institutions, des laboratoires ; dans le budget alloué ; dans l’accessibilité aux études scientifiques ; …
- En aval du travail scientifique : dans la manière dont les résultats sont formulés et publiés ; dans l’utilisation qui découlera des objets techniques comme des connaissances produites ; dans la communication qui est fait du travail auprès du grand public ; …
Chacun de ces éléments répond à un certain nombre de choix politiques. On pourrait tout de même espérer qu’entre cet amont et cet aval demeure une partie de l’activité scientifique qui se soustrait des choix arbitraires. Entre le moment où le sujet passe les portes du laboratoire et le moment où il en ressort par exemple. Mais même là, des choix demeurent : Est-ce au thésard ou au directeur de travailler sur telle question ? Quel temps alloué aux manipulations et à la rédaction ? Quelle partie de la bibliographie prendre en compte ? Quelles données utiliser ? Quels résultats est-il intéressant de présenter ? Comment la sociologie de la discipline influence la manière de présenter un résultat ? Dans quel journal faut-il publier ? Dans quel séminaire ?
On pourrait alors restreindre et imaginer qu’il existe un moment spécifique, presque sacré, où on se retrouve seul·e face à la méthode scientifique, sans plus aucun choix à faire. Il faudrait peut-être regarder dans différentes disciplines si cela est possible, mais j’imagine que pour chacune il existe à nouveau un certain nombre de choix à faire, de modèles à privilégier, de variables à négliger, de fonctions à optimiser…
Ces arbitrages-là peuvent être influencés par des réalités politiques. Pas toujours de manière saillante évidemment, mais il nous semble que l’ensemble du processus scientifique est soumis, au moins potentiellement, à des choix humains, sociaux, économiques et donc in fine politique.
Il est surement utile de les réduire au maximum. Mais, en tout cas, il nous semble délétère de faire comme si ils n’existaient pas.