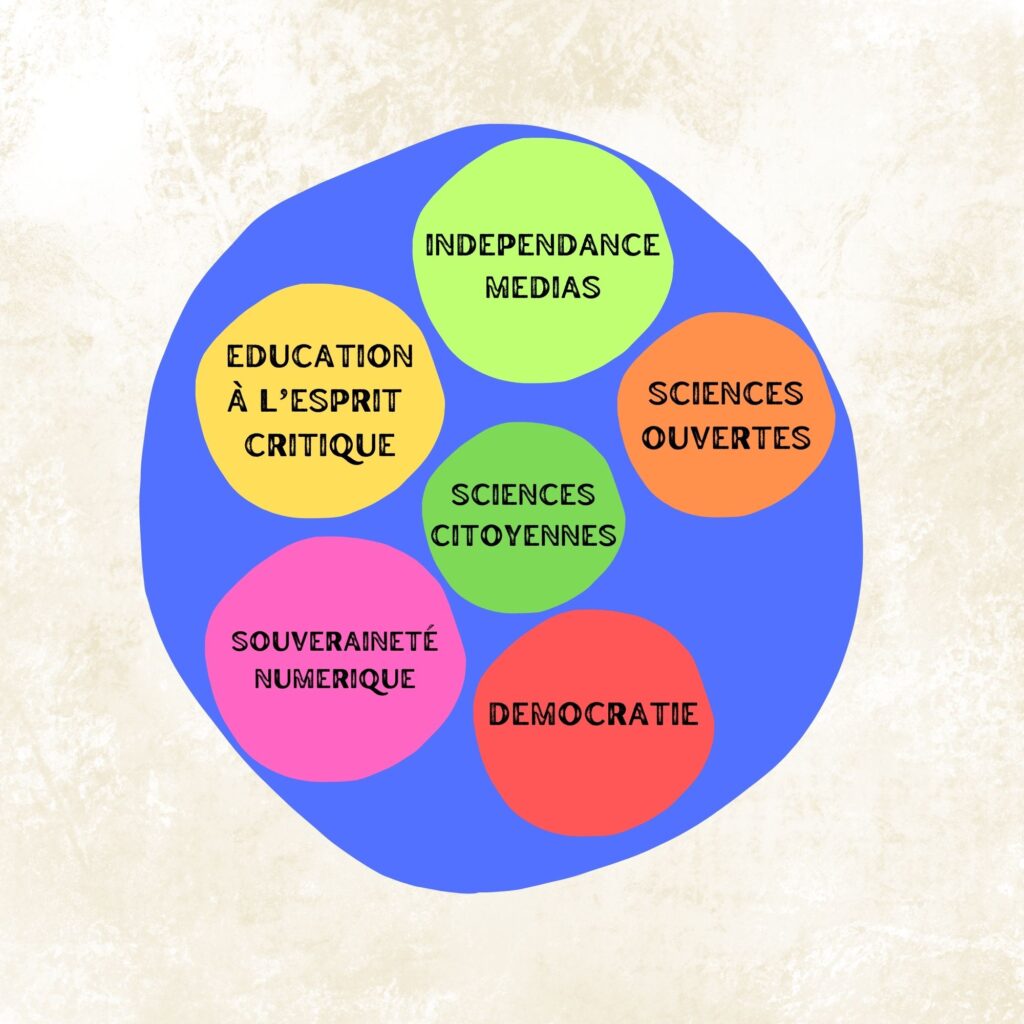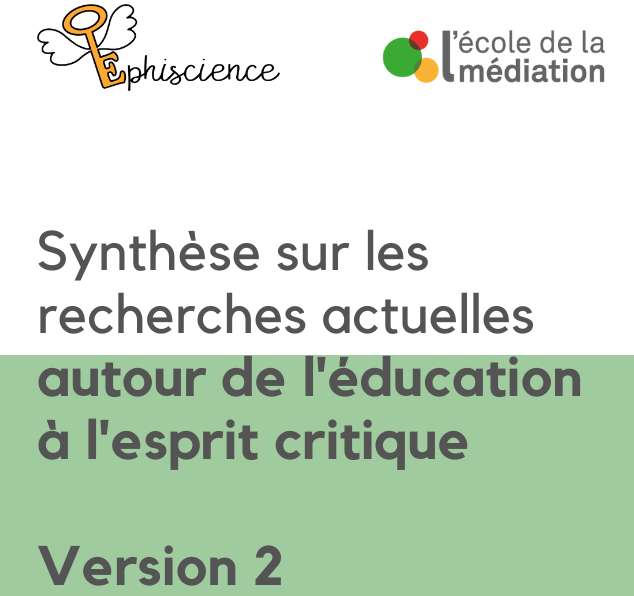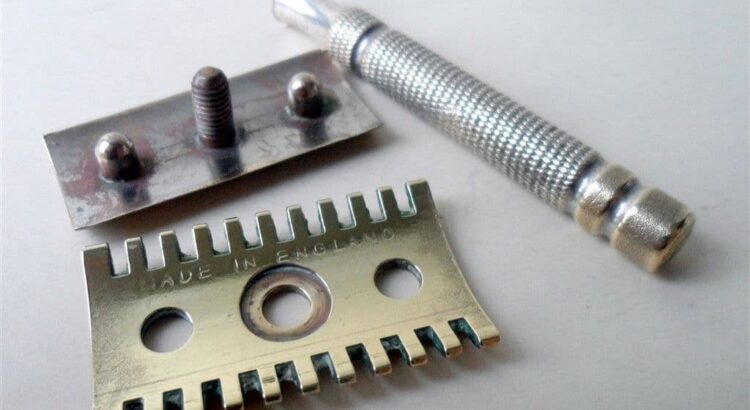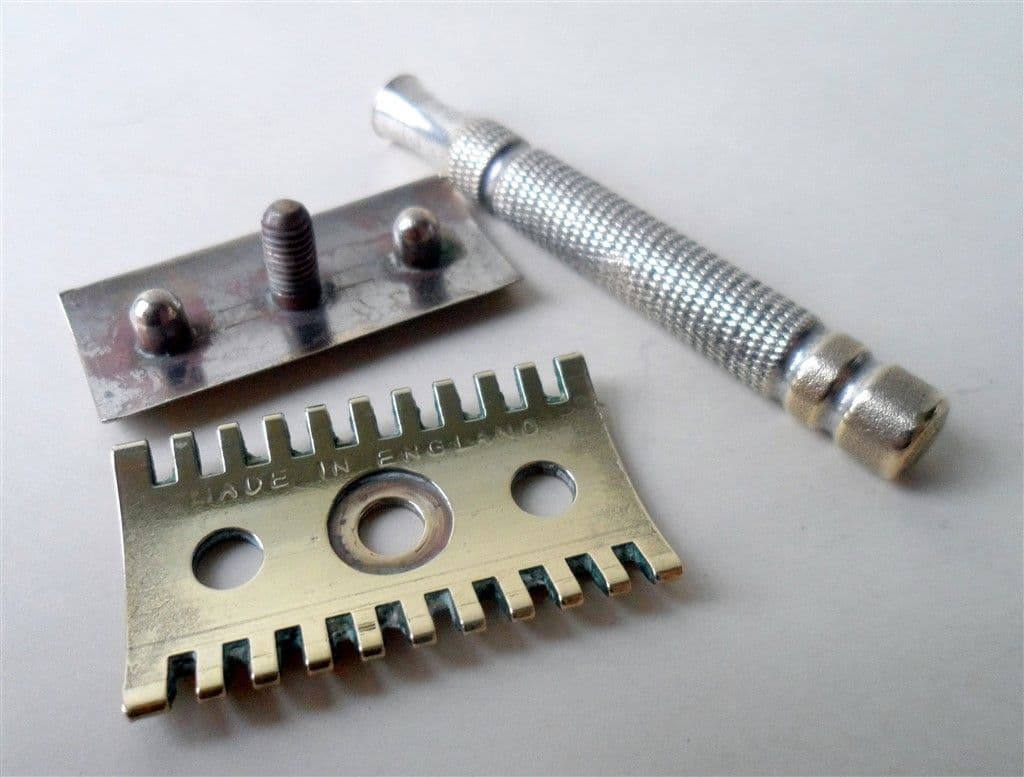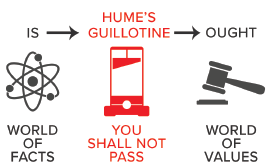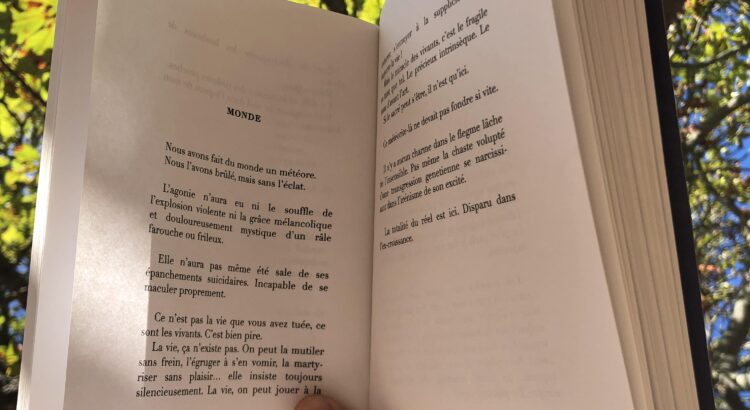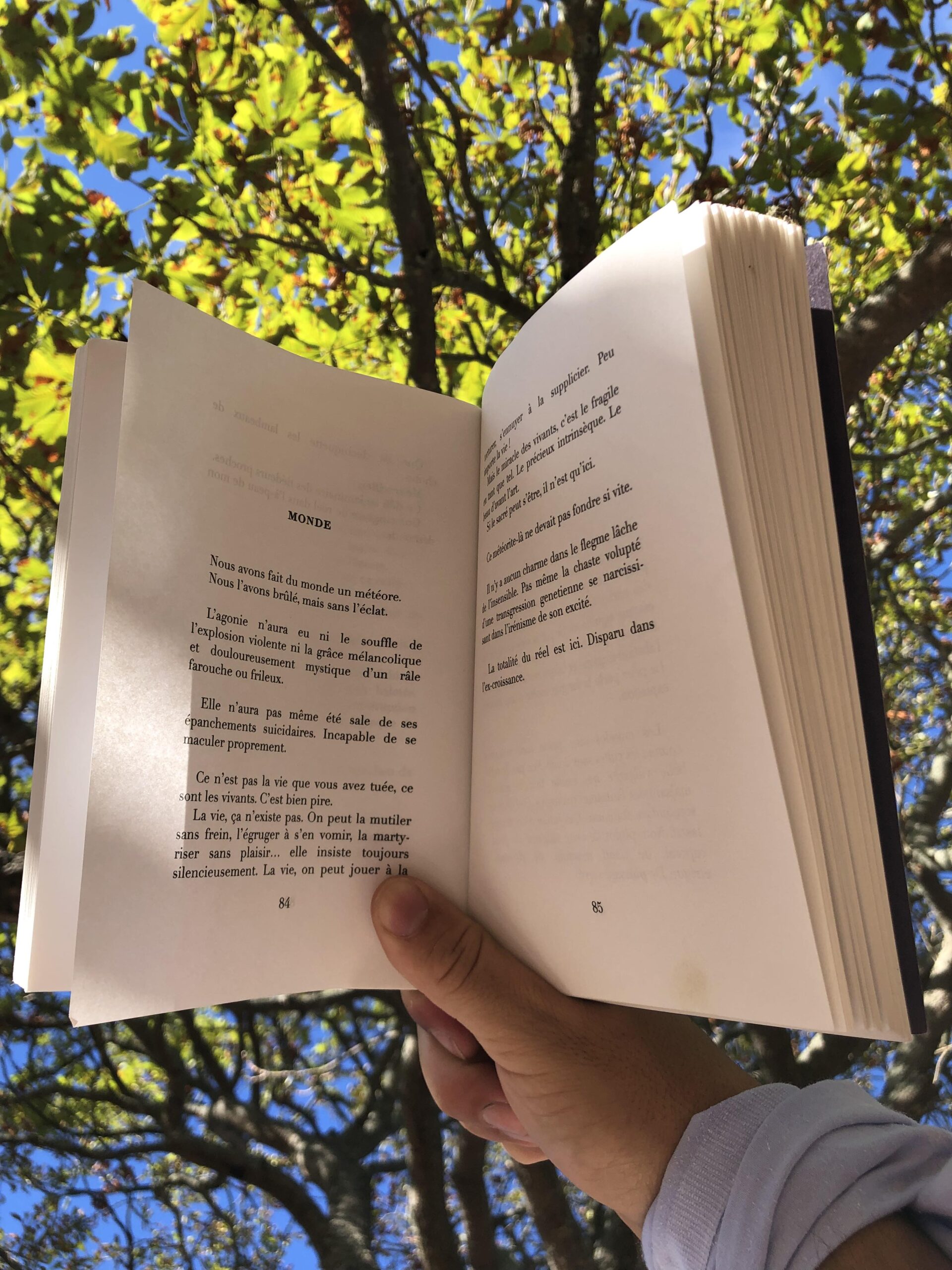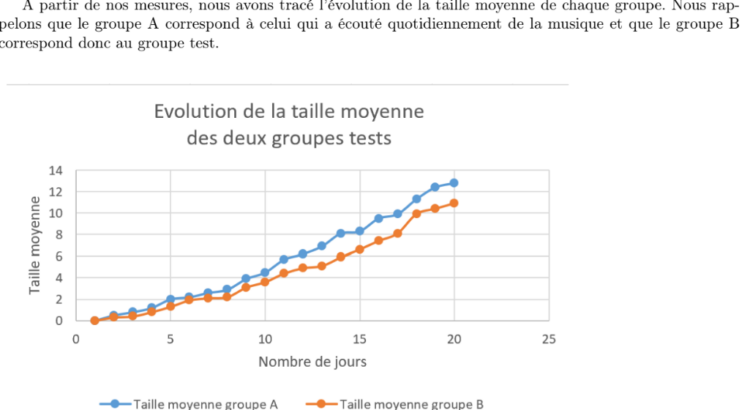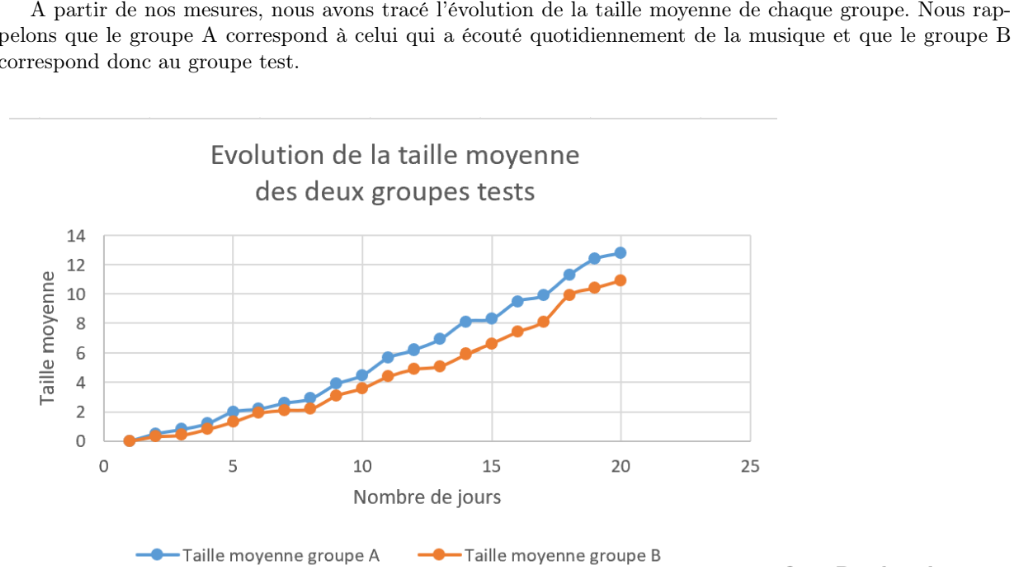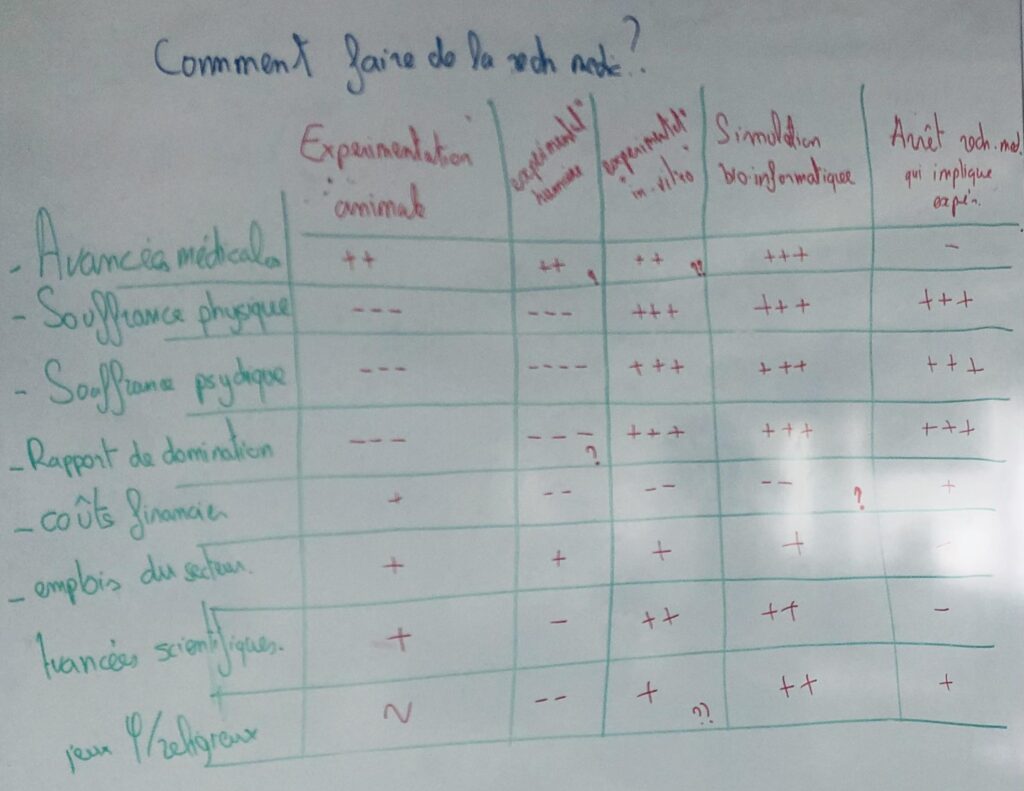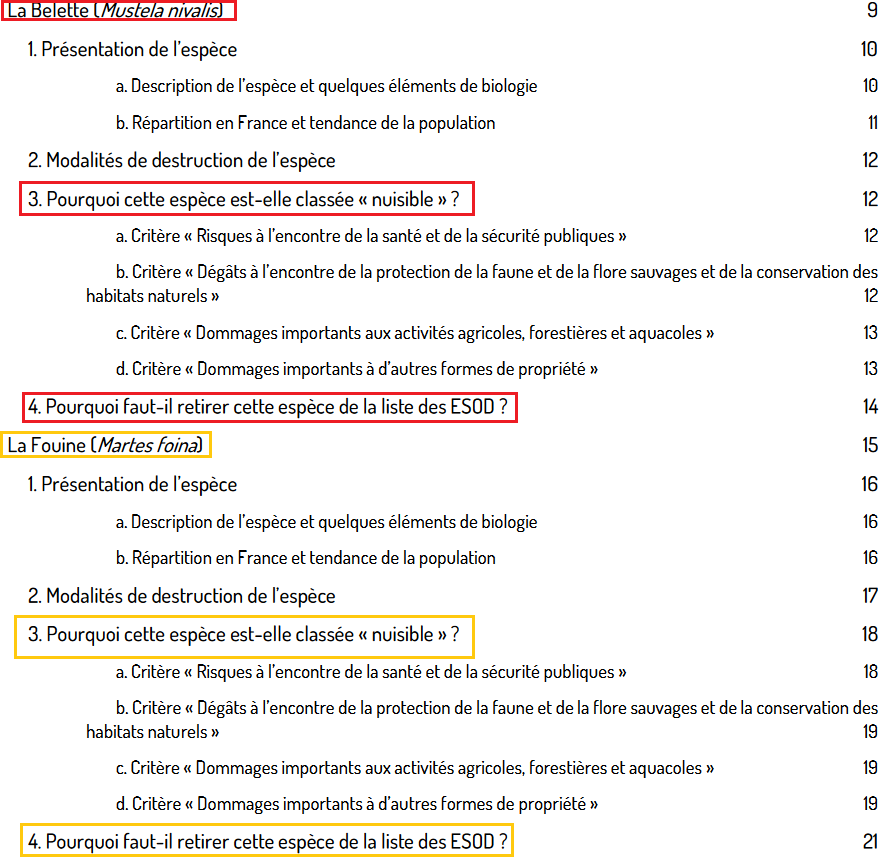Après une première édition (très) réussie en Juillet 2025, la colonie de vacances l’école d’été sceptique du Cortecs revient ! Pendant une semaine, le but est de réunir une vingtaine de personnes, d’horizons différents, intéressées par divers aspects de la pensée critique, le tout dans une ambiance conviviale, inclusive et stimulante. Vous aimez réfléchir sur l’esprit critique, participer à une belle dynamique collective et couper des légumes en parlant d’épistémologie ? Vous aimerez l’École douteuse !
La préparation avance bien et on donnera très prochainement davantage de détails sur la semaine et les infos pour postuler. En attendant, si vous êtes intéressés vous pouvez d’ores et déjà noté la date :
L’arrivée se fait le Dimanche 19, l’école se déroule du 20 au 24 et le départ se fait le 25.
Vous voulez voir à quoi ça ressemblait l’an dernier, vous pouvez jeter un œil à cet article :