 Un petit tour sur le vaste Web convainc vite qu’une théorie scientifique majeure du XXe siècle, la physique quantique, s’épanouit ailleurs que dans les labos de recherche. Médecines ou thérapies alternatives, voyance ou sectes religieuses en raffolent.
Un petit tour sur le vaste Web convainc vite qu’une théorie scientifique majeure du XXe siècle, la physique quantique, s’épanouit ailleurs que dans les labos de recherche. Médecines ou thérapies alternatives, voyance ou sectes religieuses en raffolent.
Les charlatans de la physique quantique
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | par David Larousserie
Ce grand foutoir ésotérico-thérapeutico-quantique a agacé Richard Monvoisin, enseignant en épistémologie et didactique des sciences à l’université de Grenoble. Au point de vouloir désintoxiquer le lecteur des fausses idées qui fleurissent sur la mécanique quantique, répandues par souci commercial par quelques gourous. Fidèle à la ligne de la maison d’édition Book-e-book, spécialisée en zététique, la discipline qui enseigne l’art du doute et développe l’esprit critique, l’auteur en profite aussi pour expliquer ce que dit ou ne dit pas cette fameuse mécanique quantique. Car son côté bizarre (mais qui marche, dans les transistors, les disques durs ou les lasers…) prête le flanc à moult récupérations.
L’équivalence masse-énergie sert à justifier que l’énergie du corps peut réparer ou créer de nouvelles cellules de notre organisme. La dualité onde-particule se confond avec le duo corps-esprit. Le fameux principe d’incertitude d’Heisenberg ouvre grandes les portes d’une incertitude générale de la connaissance, que d’autres notions, mystérieuses, pourraient combler. Le chat de Schrödinger, « mort et vivant », est utilisé comme preuve que la conscience peut tout. Bref, avec des mots nouveaux et des concepts scientifiques subtils, il est facile d’impressionner le chaland.
A qui la faute ?
Avec humour et pédagogie, l’auteur démonte toutes ces constructions et surinterprétations. À l’aide d’un phare, il réalise un dispositif permettant de filer plus vite que la lumière. Avec un cylindre, vu selon l’angle tantôt comme un cercle ou comme un rectangle, il crée une dualité qui, certes, n’a rien de quantique, mais qui correspond à la version faussée de quelque charlatan. Des démonstrations sans appel.
Une dernière partie, provocatrice, pose une question dérangeante : à qui la faute ? Certes, les gourous eux-mêmes peuvent séduire et tromper sciemment. Mais la faute repose aussi, selon l’auteur, sur un acteur inattendu, la vulgarisation scientifique. Autrement dit, les rois du genre que sont les mensuels Science & Vie et Sciences et avenir auraient une part de responsabilité dans ces distorsions quantiques. En jouant avec les concepts pour séduire les lecteurs, ils créeraient plus de confusion que d’information. Et planteraient des graines qui germeront en crédulité… Malheureusement, cette audacieuse et très critiquable hypothèse n’est que trop peu développée. Pour en savoir plus, le lecteur curieux devra se référer à la thèse de Richard Monvoisin, soutenue en octobre 2007, Pour une didactique de l’esprit critique (accessible sur www.cortecs.org/bibliotex).
Dans la même collection, signalons aussi la parution d’Esprit critique es-tu là ? 30 activités zététiques pour aiguiser son esprit critique. Riche et amusant.
Quantox, par Richard Monvoisin (Book-e-book, 60 p., 11 €).
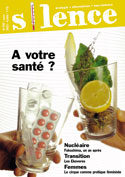
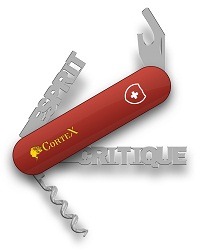

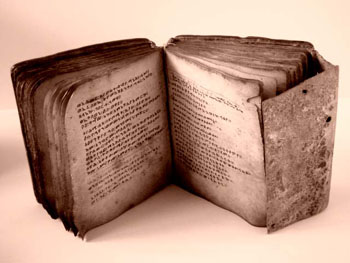


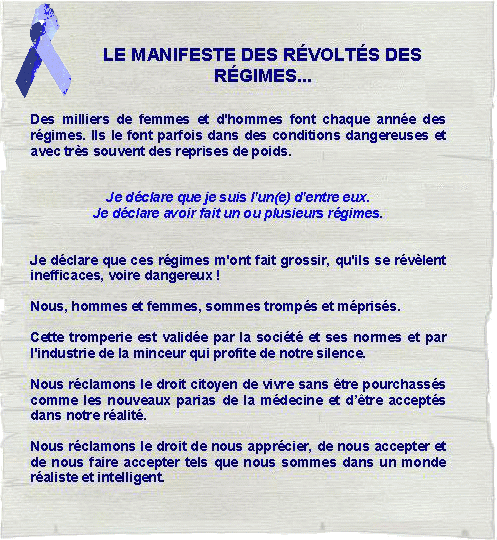
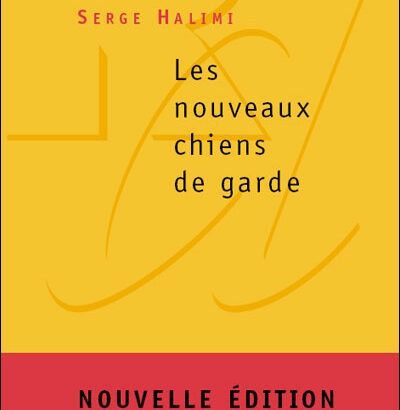
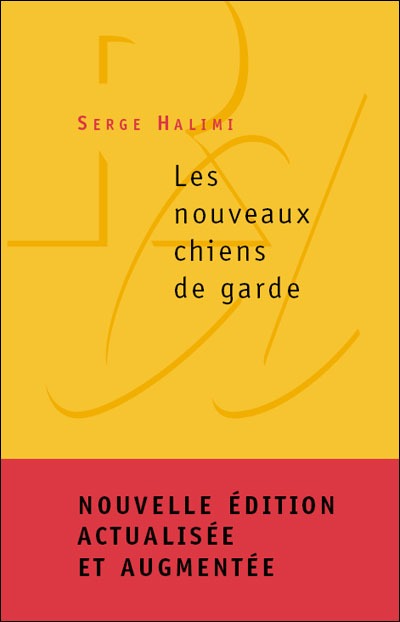 Les nouveaux chiens de garde est un essai de Serge Halimi, actuel directeur du Monde Diplomatique, paru en 1997, actualisé en 2005 et ayant pour particularité d’avoir été un grand succès de librairie (environ 150 000 exemplaires) sans jouer du marketing télévisuel qu’il dénonce dans ses pages.
Les nouveaux chiens de garde est un essai de Serge Halimi, actuel directeur du Monde Diplomatique, paru en 1997, actualisé en 2005 et ayant pour particularité d’avoir été un grand succès de librairie (environ 150 000 exemplaires) sans jouer du marketing télévisuel qu’il dénonce dans ses pages.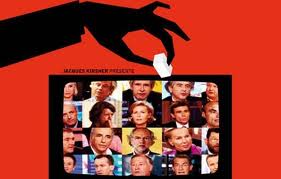
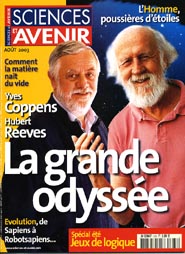


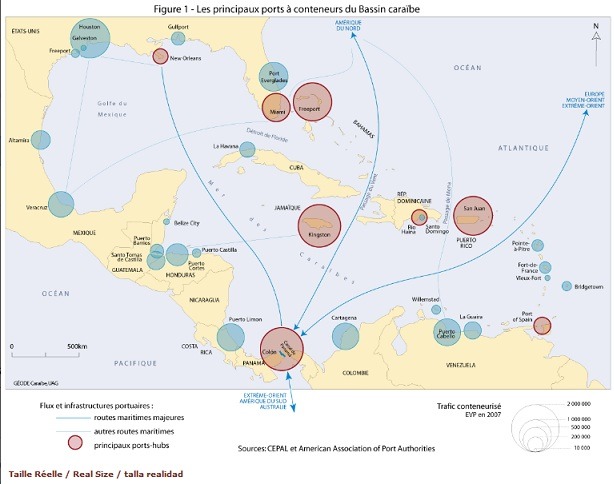

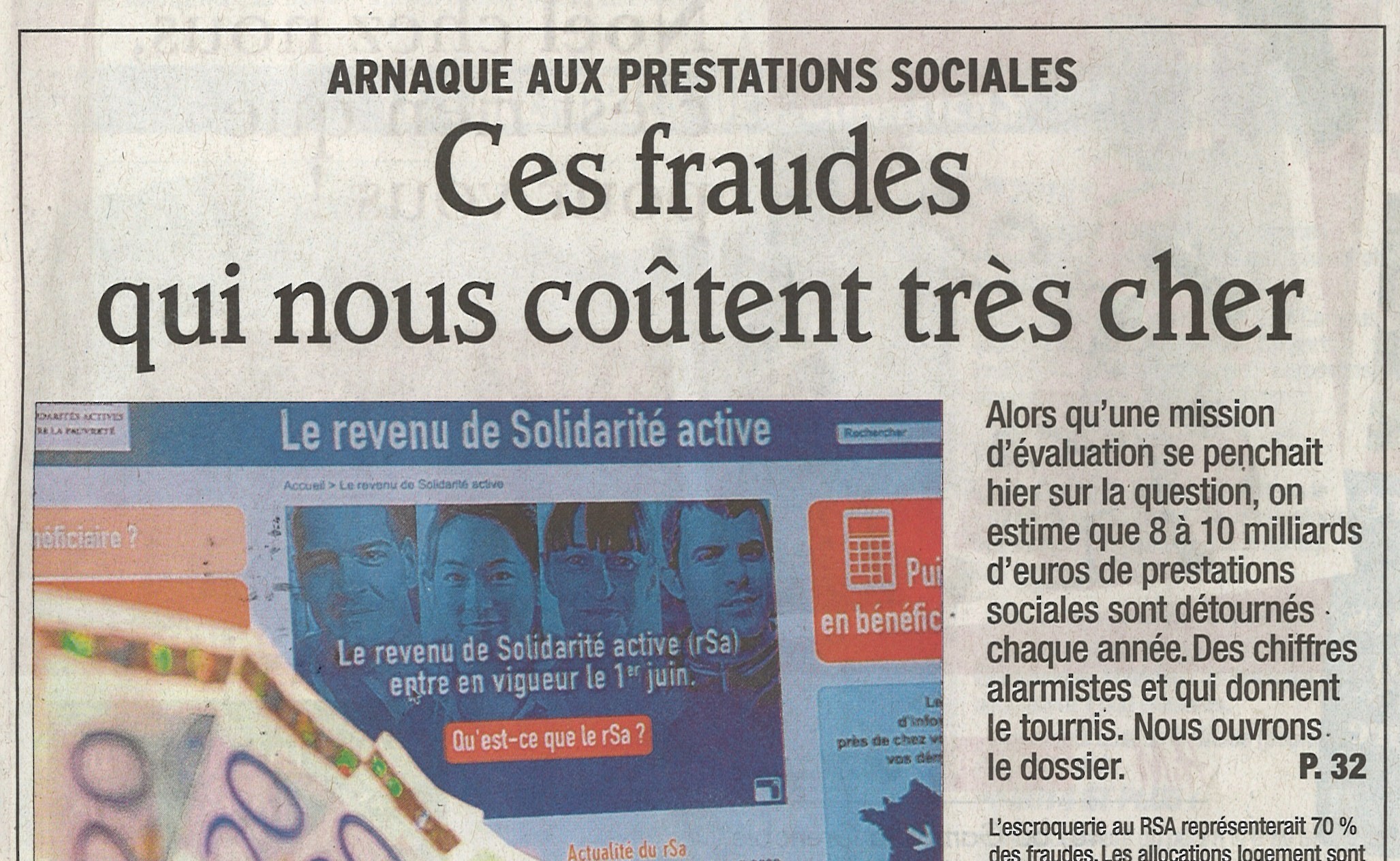
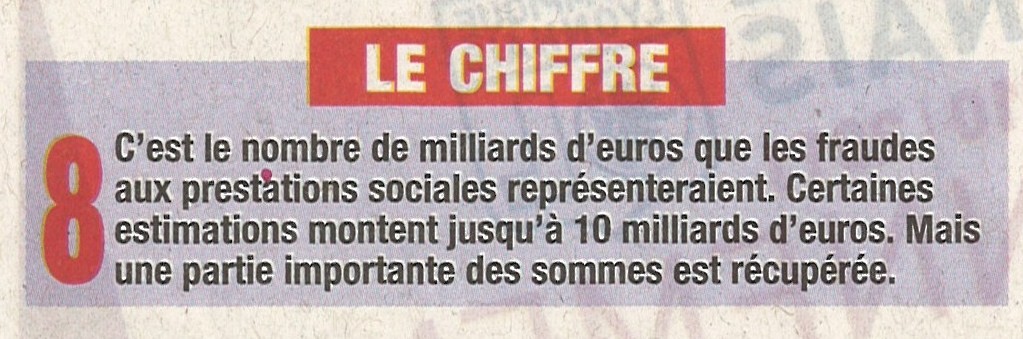

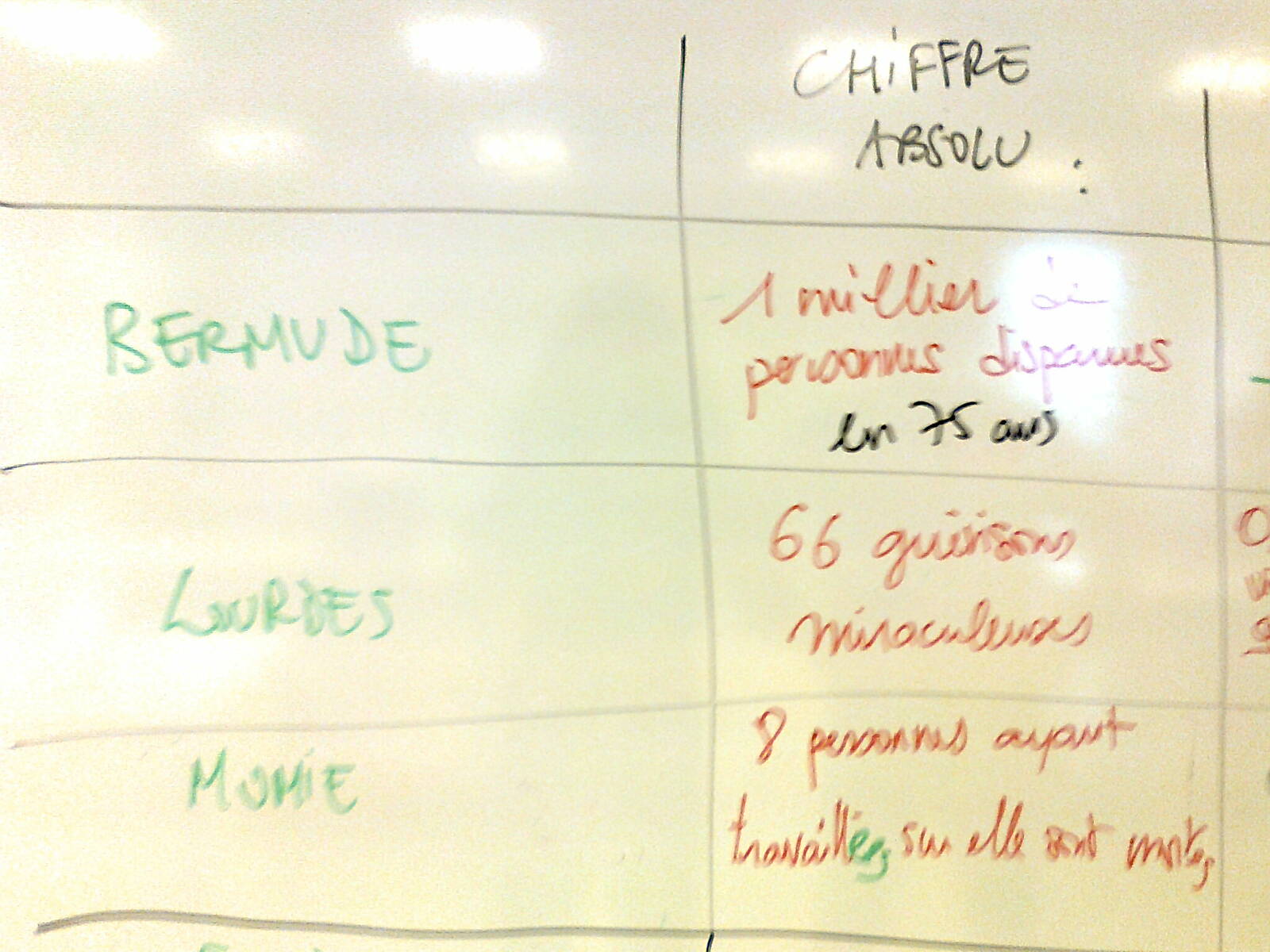
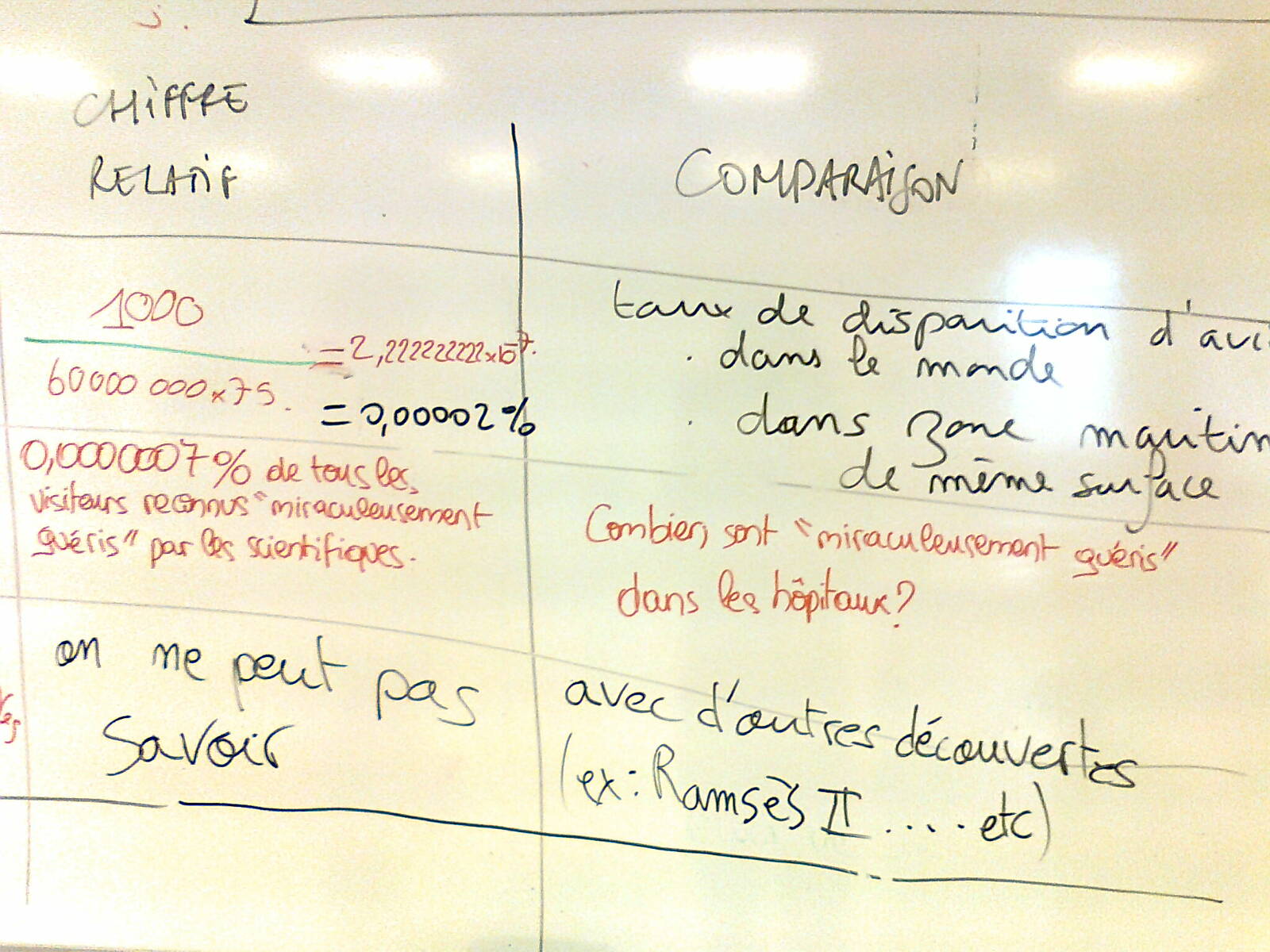


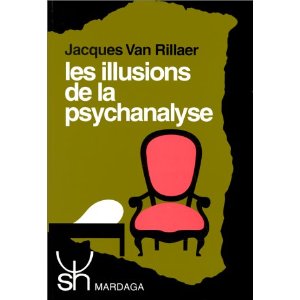 C’est un très bon matériel pour creuser le problème de l’irréfutabilité des théories psychanalytiques [1].
C’est un très bon matériel pour creuser le problème de l’irréfutabilité des théories psychanalytiques [1].
