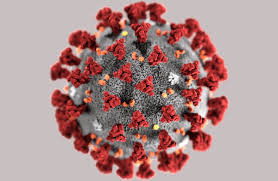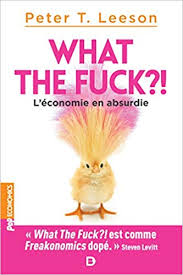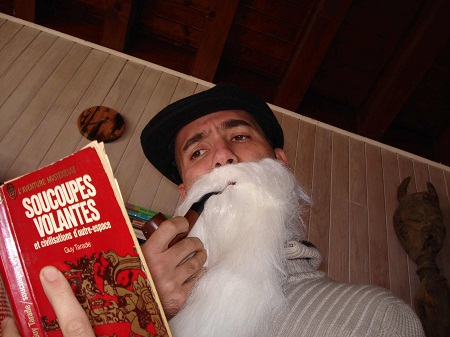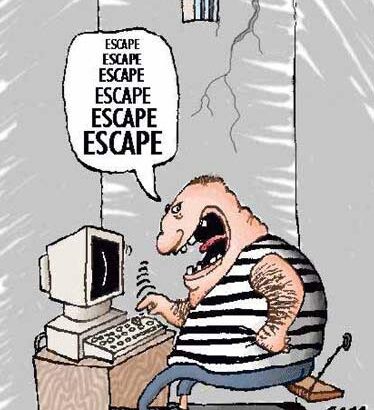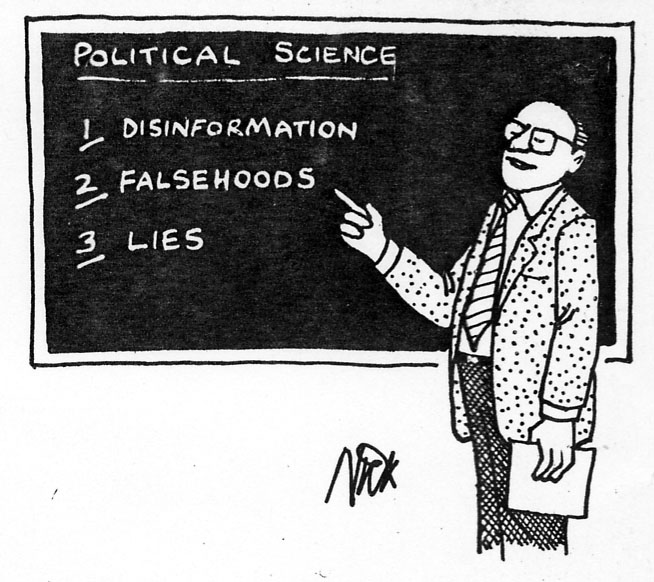Alors que le procès en cours des attaques perpétrés en janvier 2015 contre Charlie Hebdo, une policière à Montrouge et l’Hyper Cacher a réouvert le débat public sur les causes de la violence islamiste, ce dernier est devenu plus vif encore suite à l’assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020. Il est normal que lors de ces événements choquants, l’émotion rende difficile l’examen raisonné et froid des faits. Pourtant, les faits sont plus que jamais nécessaires pour se faire un avis éclairé sur les causes des attaques islamistes, leur recrudescence en France depuis 2015 et les meilleurs moyens d’y faire face. Nous regroupons dans cet article, les tentatives de Clara Egger et de Raul Magni-Berton – membres du CorteX et auteurs de travaux récents sur les causes de la violence islamiste – de remettre la raison et les faits au coeur des ces enjeux. Comme vous le verrez, la réaction des médias est édifiante.
Acte 1 – Vérités scientifiques et vérités judiciaires lors du procès Charlie Hebdo
Septembre 2020 : premier acte. Alors que la couverture médiatique du procès des attaques de janvier 2015 bat son plein, au CorteX, on trépigne et on fait le plein de matos pour nos cours de pensée critique. Las de lire dans tous les canards que ces attaques visent avant tout « la liberté d’expression », Raul est le premier à dégainer sur son blog de Médiapart 1 sur la base d’un travail de recherche récent co-écrit avec Clara Egger et Simon Varaine. 2

Le texte assez commenté et partagé, arrive aux oreilles d’un journaliste de Charlie Hebdo, Antonio Fischietti, qui traite pour le journal l’actualité et l’information scientifique. On ne le remerciera jamais assez d’être le seul à avoir pris le temps de lire l’article (c’est de plus en plus rare) alors qu’il fait partie de ceux qui ont directement perdu des proches et des collègues en 2015. Chapeau, Antonio ! Sa réponse , par contre, lapidaire et un peu moqueuse 3, ne nous convainc pas franchement et révèle un manque de compréhension des études statistiques en sciences sociales.
Elle offre toutefois l’occasion à Raùl de reprendre, point par point, les contre-arguments avancés 4.On retiendra de cet échange qu’en matière de violence islamiste, l’application du rasoir d’Occam est à la peine. Parmi toutes les hypothèses pouvant expliquer la survenue d’attentats, certaines sont a priori écartées malgré les preuves accumulées en leur faveur. On comprendra pourquoi dans le second acte de cette controverse.
Acte 2 – Cachez ces études statistiques que je ne saurai pas voir
Novembre 2020 : second acte. A l’occasion d’un débat opposant personnalités du monde académique, des arts et de la culture et chercheurs en études stratégiques sur l’impact de la guerre sur les attaques islamistes, Raul remet le couvert, cette fois accompagnée de Clara. Leur tribune publiée dans la section Débats de l’Obs 5, étaye l’argument selon lequel, il existe en France un déni sur le rôle que joue les interventions militaires extérieures dans les pays musulmans sur la probabilité d’être ciblé par une attaque islamiste. On ne s’attendait pas à ce que telle conclusion, banale dans les cercles d’experts sur le sujet, suscite autant de réactions négatives. La palme d’or à ce journaliste à qui revient le mérite de la réponse la plus explicite : « l’argumentation statistique ici donne presque l’illusion que la vengeance des terroristes est, sinon légitime, du moins compréhensible ».