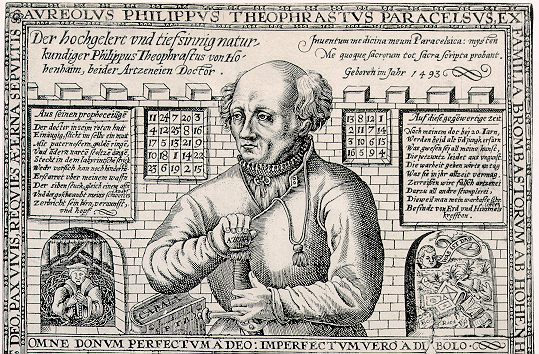Un cas de vente de la peau de l’ours ?
Les médias de vulgarisation sont très prompts à vendre des résultats qu’ils n’ont pas encore obtenus, des découvertes qu’ils n’ont pas encore faites, et des espoirs qui se révèlent vite déçus. Nous appelons ça la technique de la peau de l’ours (voir ici).
Yves Mulet Marquis nous a envoyé ceci fin juillet 2011.
 « En soutien à votre action contre le méusage de la science, je voudrais attirer votre attention sur un article de la revue Science et Vie N°1127 d’aout 2011, page 130.
« En soutien à votre action contre le méusage de la science, je voudrais attirer votre attention sur un article de la revue Science et Vie N°1127 d’aout 2011, page 130.« En quoi les airelles protègent-elles des infections urinaires ».
L’article, page 130 (cliquez ici), me semble très optimiste par rapport aux bienfaits supposés du jus de canneberge sur les infections urinaires. L’étude citée de Tero Kontiokari, datant de 2001 est contredite par de plus récentes. Contrairement à ce qui est affirmé dans l’article, l’avis cité de l’Afssa (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé), publié en 2004, ne conseille pas la consommation du jus de canneberge. Il indique simplement à la Direction générale de la Concurrence de la Consommation et de la Repression des Fraudes que sur un plan légal l’allégation « contribue à diminuer la fixation de certaines bactéries E. coli sur les parois des voies urinaires » est acceptable uniquement pour le jus du fruit de la plante Vaccinum macrocorpon et la poudre de jus du fruit de cette plante au vu des études disponibles à cette date (voir le rapport).En 2009 l »European safety authority » a conclu qu’il n’existait pas de preuve suffisante d’une relation de cause à effet entre la consommation de jus de canneberge et la réduction des infections urinaires (voir l’article). En 2011 le Département d’Epidémiologie de l’Université d’Ann Arbor dans le Michigan a conclu au terme d’une expérience en double aveugle que la consommation du jus de canneberge n’entrainait aucune réduction des infections urinaires ».


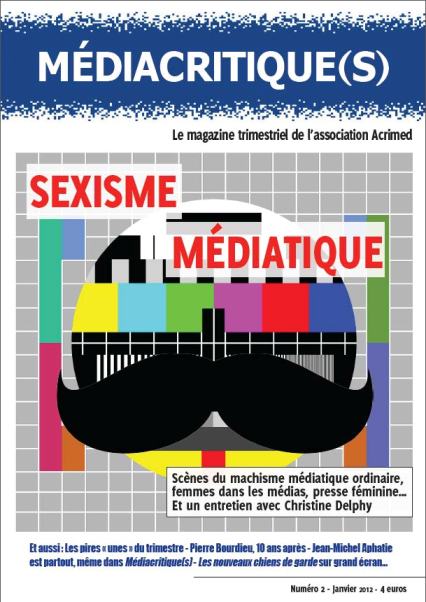


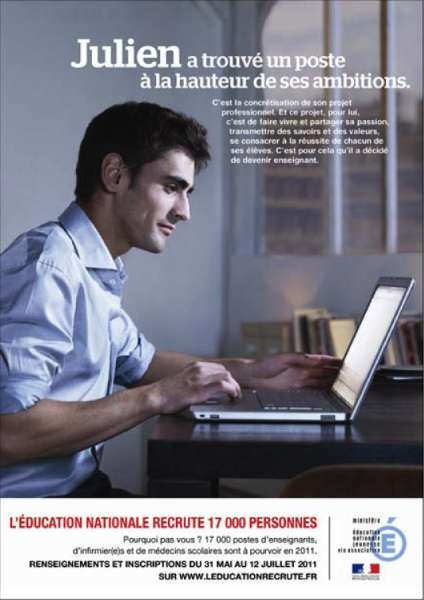 Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions.
Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions.











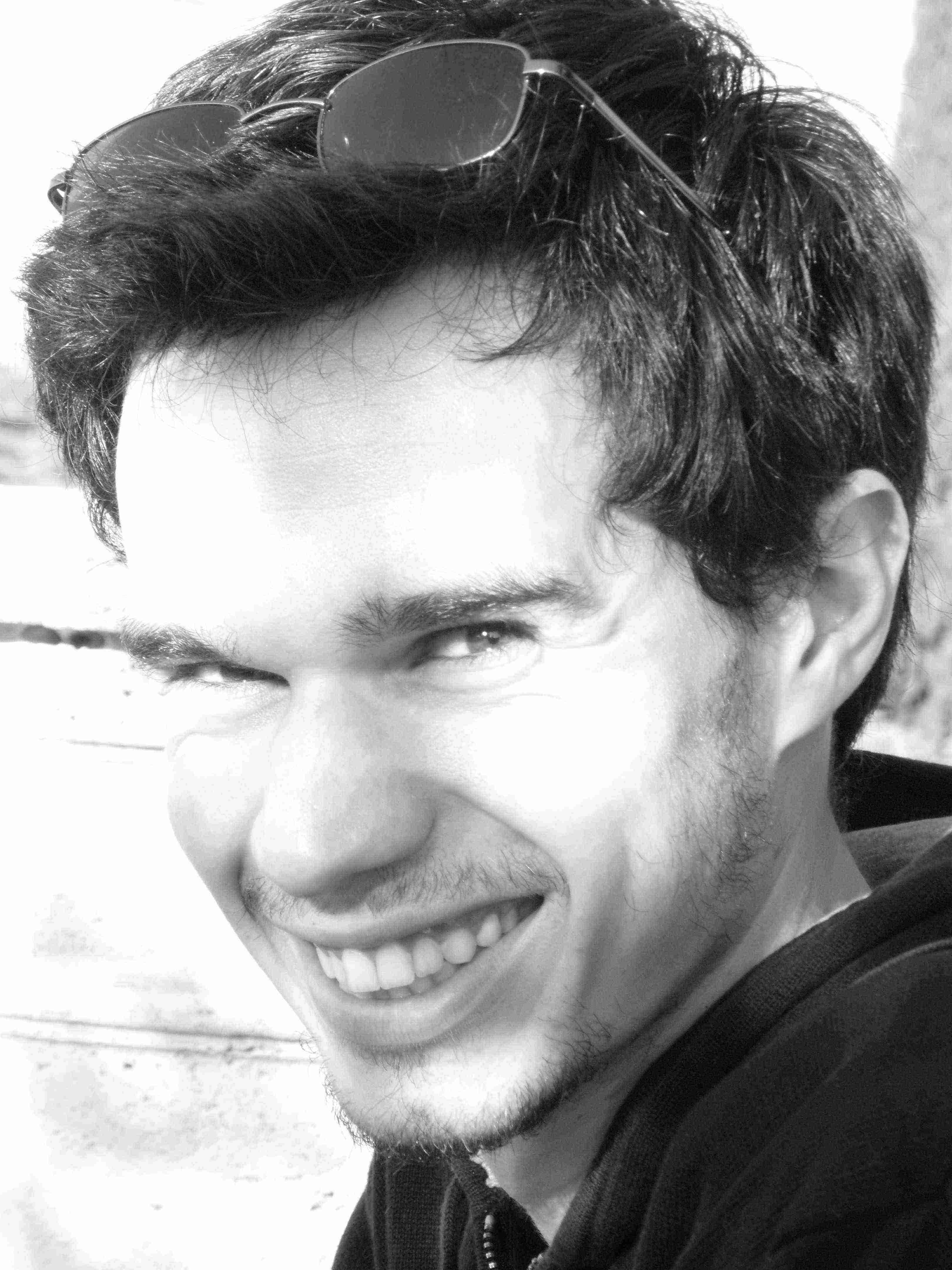



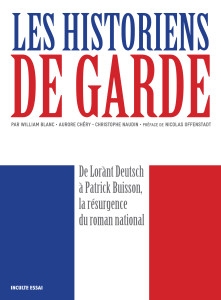

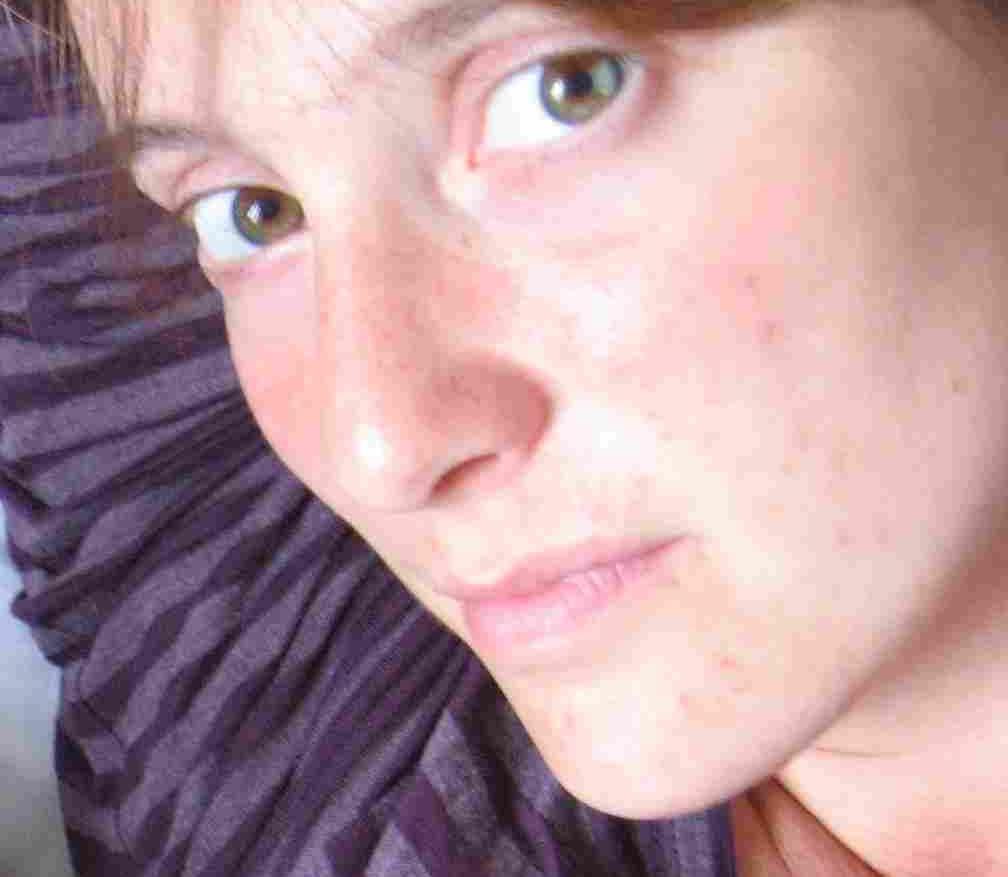
 éditions Belin) :
éditions Belin) :