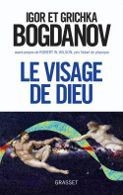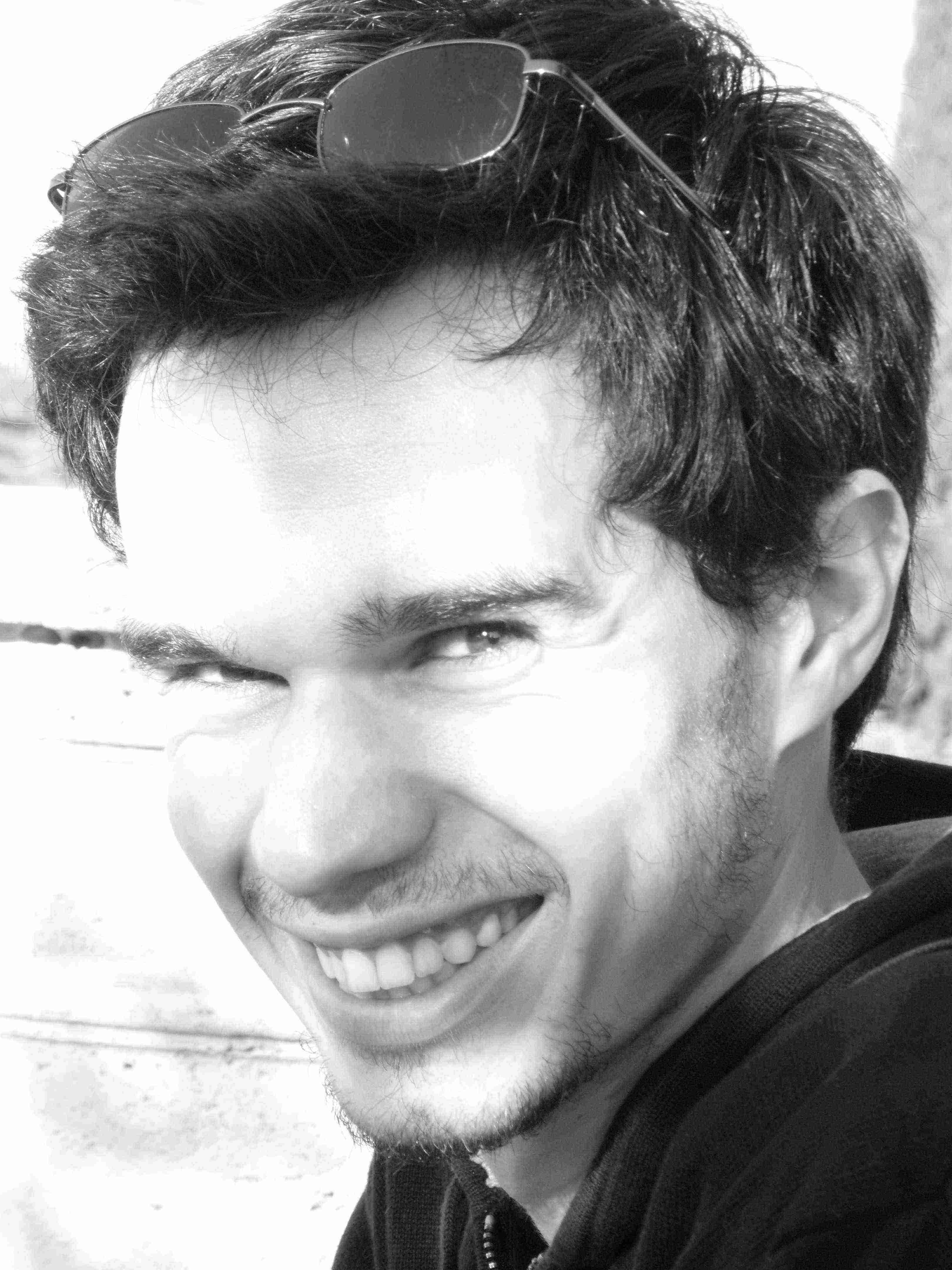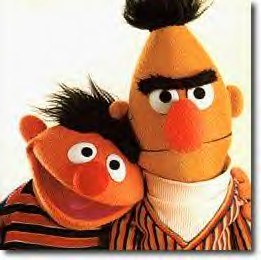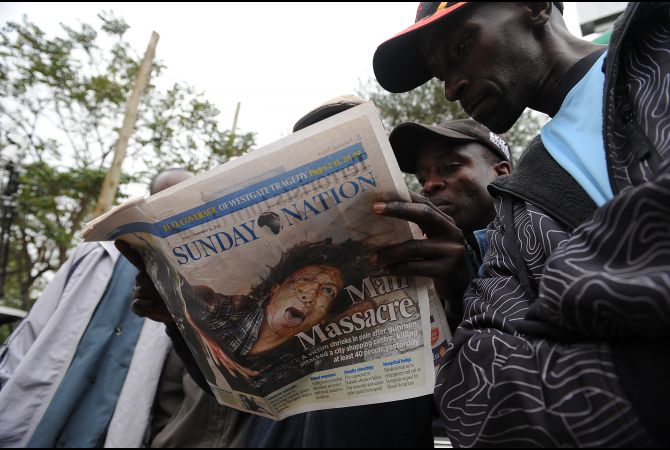Le 10 juin 2014, quatre syndicats ont appelé les cheminots à une grève reconductible. Le 11 juin au matin, j’étais à l’écoute du traitement médiatique donné à ce mouvement d’ampleur nationale. Je me suis intéressé plus particulièrement à trois émissions de radio très écoutées sur le créneau 6h-9h : Europe Matin (Europe 1, Thomas Sotto), RTL Matin (RTL, Laurent Bazin) et Le 7/9 (France Inter, Patrick Cohen). L’analyse de ces émissions minute par minute m’a permis de mettre en lumière les stéréotypes associés à la grève ainsi que les mécanismes de la fabrication de l’information et de l’opinion, fondés sur un biais simple et redoutable : le tri sélectif des informations.
Le 10 juin 2014, quatre syndicats ont appelé les cheminots à une grève reconductible. Le 11 juin au matin, j’étais à l’écoute du traitement médiatique donné à ce mouvement d’ampleur nationale. Je me suis intéressé plus particulièrement à trois émissions de radio très écoutées sur le créneau 6h-9h : Europe Matin (Europe 1, Thomas Sotto), RTL Matin (RTL, Laurent Bazin) et Le 7/9 (France Inter, Patrick Cohen). L’analyse de ces émissions minute par minute m’a permis de mettre en lumière les stéréotypes associés à la grève ainsi que les mécanismes de la fabrication de l’information et de l’opinion, fondés sur un biais simple et redoutable : le tri sélectif des informations.
[TOC]
Les trois émissions sont disponibles directement sur les sites des radios : – Europe 1 Matin – RTL Matin – Le 7/9 ; à récupérer ici : Europe 1 ; RTL ; France Inter partie 1 et partie 2
Préalable
Comme on le verra dans la suite, la grève est toujours présentée comme de la responsabilité des cheminots, jamais de celle du gouvernement ou des patrons. Qui a raison ? Si la réforme proposée est désastreuse tant pour les cheminots que pour les usagers, n’est-ce pas eux (patrons, gouvernement) qui devraient être tenus pour responsables des tensions ? On pourrait tout aussi bien dire que c’est le gouvernement qui provoque la panique dans les transports en n’allant pas dans le sens des revendications des cheminots. Comment savoir ?
Pour nous faire un avis sur la grève, il nous faut donc : – le contenu du projet de « réforme » – ce que dénoncent les cheminots – pourquoi SNCF n’accède pas aux revendications des cheminots (en quoi ils ne sont pas d’accord)
Sans cela, il est impossible de comprendre les raisons du conflit et de se faire un avis en connaissance de cause. Quid des émissions de radio qui nous « informent » en cette matinée de grève ?
Le choix des radios et de l’analyse
Le choix des émissions est basé sur un double critère : elles font partie des trois émissions d’information les plus écoutées sur cette tranche horaire (voir ici) ; ce sont également celles que j’écoute le plus souvent quand j’ai le temps.
Le choix du créneau est discutable mais, je pense, cohérent : les émissions d’informations à la radio sont concentrées majoritairement le matin et en fin d’après-midi. J’ai choisi le matin, par facilité.
Concernant l’analyse de ces émissions, après une écoute complète de chacune d’entre elles, j’ai noté chaque passage où il était question de la grève des cheminots, en notant le temps consacré et la nature des propos tenus. J’ai mesuré le temps de parole des animateurs/journalistes sur le sujet ainsi que le temps accordé aux différentes entrevues et reportages, toujours sur ce même sujet.
Les raisons de cette analyse
C’est au petit-déjeuner que j’ai décidé de prendre le temps de l’analyse : en l’espace d’une demi-heure d’écoute (Europe Matin), j’avais entendu une kyrielle de témoignages d’usagers mécontents qui m’avaient convaincu que cette grève, comme tant d’autres lorsqu’il est question de transport ou d’éducation, allait perturber et gêner des milliers de personnes dans le pays. La grève était décrite du début à la fin comme un sale moment à passer. En revanche, je n’avais toujours aucune idée des raisons qui avaient poussé les cheminots à lancer cette grève.
Je me suis honnêtement posé la question : avais-je subi un tri sélectif des données ? M’étais-je exposé sélectivement aux informations allant dans le sens de mes attentes (à savoir un traitement médiatique partisan et « grèvophobe ») ? N’avais-je gardé en mémoire qu’un seul pan de celles-ci et oublié les entrevues des syndicats à l’origine du mouvement et les débats contradictoires présentant les différents points de vue ? Avais-je simplement raté ces plages d’informations au cours de la matinée ? Pour le savoir, j’ai donc décidé de mener l’enquête et d’écouter du début à la fin, d’abord l’émission en question (Europe Matin), puis deux autres, pour étoffer cette analyse. Voici ce que j’ai trouvé.
Limites : cette grève de SNCF intervient le même jour que celle des taxis, générant une exposition médiatique accrue autour des désagréments et perturbations causés par ces deux mouvements. J’ai donc distingué dans la suite les durées consacrées à la grève des cheminots de celles évoquant la grève des taxis.
Résultats
Europe Matin (6h-9h)
Trois heures d’émission mais seulement 2h30 environ sans les publicités.
L’équipe de Thomas Sotto a consacré presque 19 minutes (18’52) au traitement de la grève des cheminots. Sur cette durée, j’ai compté 7’05 pendant lesquelles il était question des raisons de la grève (soit dans les titres : « […] pour protester contre la réforme visant au rapprochement entre la SCNF et RFF« , soit dans des entrevues ou des discussions avec invités autour de cette question).
Sur ces 7 minutes, aucun temps n’a été consacré à la parole des cheminots, syndiqués ou non. 3’05 ont permis à un éditorialiste (Axel de Tarlé) de revenir soi-disant sur les raisons de la grève (il répondait à la question « Pourquoi cette grève »). Or, à aucun moment il n’évoque les véritables problèmes avancés par les cheminots et se centre uniquement sur l’aspect concurrentiel du marché ferroviaire.
Un deuxième temps (vers 1h07 d’émission, durée 3’45) est introduit par la co-animatrice avec cette phrase « Les corporatismes sont-ils en train de bloquer le pays ? ». Il est consacré à l’entrevue d’un invité, Mathieu Laine, présenté comme libéral et qui, dans les premières secondes, déclare que les français sont de petits rentiers, incapables de voir loin. Le ton est donné, bien loin d’une analyse des raisons de la grève des cheminots. Seul Thomas Sotto tente de répondre aux caricatures et autres raccourcis de l’invité sans pour autant entrer dans une véritable contre-argumentation solide.
Au final, sur ces 18’52, la part consacrée aux raisons de la grève (c’est-à-dire où l’on a évoqué a minima le pourquoi du mouvement) s’élève à 37,5% si l’on inclut l’entrevue de Mathieu Laine, et à 8,9% si on retire celle-ci. Par ailleurs, le temps d’antenne donné aux cheminots est égal à zéro.
RTL Matin
Deux heures d’émission (7h-9h), environ la même proportion de publicité (environ 25 min).
Sur ces deux heures, j’ai comptabilisé 11 minutes évoquant la grève des cheminots. Sur ces 11 minutes, aucun invité et aucune entrevue de cheminots ou syndicalistes. Le seul moment où l’on entend parler des raisons de la grève se situe au bout de 2’30 d’émission : « La CGT et Sud se sont lancés dans un mouvement reconductible, ils protestent contre le projet de réforme ferroviaire qui doit rapprocher Réseau Ferré de France et la SNCF »
Il n’y en aura pas d’autres.
Cela représente 5 secondes sur les 11 minutes, soit 0,75% du temps consacré, pour le reste, aux témoignages des usagers et à l’état du trafic.
Le 7/9 (France Inter)
L’émission dure deux heures, sans publicité. Sur ces deux heures – essentiellement des informations, entrevues et reportages – j’ai compté 15 minutes sur la grève, dont 7’05 sur les raisons de celle-ci. Dans le détail, 40 secondes de titres et autres lancements reviennent sur les raisons de la grève en une phrase ou deux. On compte néanmoins une entrevue en studio du secrétaire général de la CGT cheminot, Gilbert Garrel (6’25), et une autre, plus rapide, d’un délégué CGT (30 secondes).
En dehors de ces temps-ci, les 8 autres minutes donnent la parole aux usagers en général mécontents ou résolus et à l’état du trafic.
La durée consacrée aux explications représente 46,1% du total d’informations sur la grève, l’essentiel de ces raisons étant données par les syndicalistes de la CGT.
Analyse du discours
Que ce soit sur Europe 1, RTL ou France Inter, une grande partie du temps d’antenne a été donnée à la parole des usagers, pour la quasi-totalité mécontents de la grève (je n’ai pas fait de relevé précis mais les avis positifs ne sont apparus que ponctuellement). Deux questions viennent alors : quelles informations arrivent à l’oreille de l’auditeur sur la grève autres que les problèmes rencontrés par les usagers ? Quelle impression sera retenue par l’auditeur qui, pour plus de 99% du temps d’information comme sur RTL, entendra des personnes énervées et contre les effets de la grève. Car c’est de cela dont il s’agit : les effets de la grève sont désagréables et privent parfois des milliers de personnes de leur moyen de transport habituel. Que l’accent soit mis uniquement sur cet aspect doit nous interroger et nous questionner sur cette fabrique de l’opinion engendrée par l’occultation des journalistes et/ou des rédactions de la partie « pourquoi » une telle grève ? Certes, ce traitement médiatique est différent selon les radios et si RTL se démarque par une quasi-absence d’information sur les raisons de la grève, Europe 1 y consacre environ un tiers de son contenu (avec un fort parti pris en défaveur des grévistes, sans consacrer à ceux-ci en retour une seule minute de temps de parole) quand France Inter ne dépasse pas les 47% ; elle est néanmoins la seule radio à avoir interrogé des représentants des cheminots.
Appel à la pitié et tri sélectif des données
Les nuisances ont donc pris le dessus sur les raisons de la grève. Chaque titre, chaque lancement met en avant celles-ci, consacrant une écrasante majorité des journaux ou reportages aux témoignages (négatifs), aux retards, aux annulations, aux bouchons, etc. L’usager est le sujet de la grève et le recours à différents sophismes tel cet appel à la pitié présentant une lycéenne devant partir presque cinq heures plus tôt pour être certaine de ne pas rater l’épreuve du baccalauréat qu’elle doit passer en début d’après-midi (Europe 1, vers 1h19′), renforce l’image négative associée aux grévistes, responsables du stress de cette élève… (sur ce point, voir cet excellent article sur le site d’Acrimed, paragraphe 2)
Le leitmotiv : être au plus près des gens, avec une sorte de règle qu’Aubenas et Benasayag appellent la loi de proximité :
« Il y a bien sûr quelques règles édictables et aisément compréhensibles. La plus célèbre reste sans doute cette antique loi de la proximité, vieille comme la presse et dont l’équation s’applique dans toutes les rédactions du monde : il faut diviser le nombre de morts par la distance en kilomètres entre le lieu de l’événement et le siège du journal pour trouver la taille de l’article finalement publié. Un accident de train, gare de Lyon à Paris, sera ainsi bien plus «couvert» par la presse nationale (dont les bureaux sont dans la capitale), qu’un accident comparable à Marseille, sans même parler d’un déraillement mortel en Inde ou en Afrique. » La fabrication de l’information, les journalistes et l’idéologie de l’information, La découverte, p 34, 2007.
Si cette règle guide les choix au sein des rédactions, alors, même le fait de cibler uniquement les effets concrets et immédiats d’une grève est tout à fait rationnel, contestable certes, mais cohérent en regard de l’objectif mercantile de la vente avec profit de cette marchandise qu’est l’information. Les raisons de la grève – dont l’effritement du service public et les risques pointés en termes de coût ou de sécurité – touchent elles-aussi concrètement et directement ces mêmes usagers interrogés, mais de façon plus lointaine et moins palpable comparé aux nuisances bien réelles pour celles et ceux qui attendent leur train depuis des heures.
Dans cet extrait du Petit Journal de juin 2013 (vers 5’30) on appréciera la manière dont on peut fabriquer une opinion en fonction du montage choisi lors d’un micro trottoir :
Le Petit Journal a-t-il lui aussi effectué un tri sélectif des données en ne sélectionnant que des gens avançant à la fois des propos « gentils » et des propos plus durs ? Peu importe : avant de tirer une quelconque conclusion d’un micro trottoir ou plus largement d’un sondage, il faut d’abord s’assurer au moins de ceci : quels sont les biais de sélection (le journaliste n’a-t-il gardé que les cas qui l’intéresse ?), les biais d’échantillonnage (faire le sondage à 14h dans une rue bourgeoise n’est pas la même chose que dans un quartier de banlieue à 23h), les critères d’inclusion (certains avis ont été retirés : est-ce parce qu’inaudibles ? Parce qu’allant contre l’avis du journaliste ?), etc. Henri Broch, dans Le Paranormal, donne ce conseil judicieux qui recouvre ces points : « le mode d’inclusion et de rejet des données doit être significatif et précisé à l’avance ».
Effet impact
J’ai également écouté le vocabulaire utilisé par les animateurs et présentateurs des informations : celui-ci porte sur le même registre tout au long de l’émission, avec quelques variantes, généralement négatives en regard des perturbations occasionnées par la non-circulation des trains.
J’ai noté : « Nouvelle journée de galère (E1) » ; « Bon courage, E1 vous accompagne » ; « Grève qui complique la vie des usagers (E1) » ; « A la gare du Nord, on vit déjà un cauchemar éveillé (RTL) » ; « C‘est un mercredi de galère, on vient de dépasser les 300km de bouchons (RTL) » ; « Matinée très douloureuse pour beaucoup d’entre vous (RTL) » ; « Ce sera compliqué sur les routes (Inter) » ; « Usagers en mode tortue (Inter) » ; « Un mercredi haut en couleurs, noir sur les rails… (Inter) »
Ce lexique avait été déjà pointé dans le film Les Nouveaux Chiens de garde, de Serge Halimi, adapté par Gilles Balbastre et Yannick Kergoat en 2012.
Sur le terme « noir » :
Sur le terme « galère » :
Pour présenter les raisons de cette grève (plus ou moins rapidement on l’a vu), Europe 1 et RTL ont utilisé le même type de vocabulaire : les cheminots protestent contre la réforme. Sur France Inter, je n’ai noté qu’une seule phrase sur le même mode et le verbe utilisé était différent puisque les cheminots étaient ici mobilisés contre la réforme. Avant de revenir sur la connotation de ces deux verbes, qu’en est-il de leur dénotation (leur sens réel) ? Protester signifie littéralement manifester son opposition (voir une définition possible ici). Mobiliser signifie faire appel à, mettre en oeuvre (si l’on exclut l’aspect militaire, mettre sur le pied de guerre).
La connotation de ces termes est bien différente : en cherchant les synonymes, on a une idée assez bonne de l’effet impact obtenu par leur utilisation. Pour « protester », on trouve une connotation proche de râler, ronchonner, rouspéter, grogner. Pour « mobiliser », on trouve des verbes comme grouper, liguer, enrôler, lever.
Quel impact procure ces deux termes sur notre perception du mouvement de grève ? Si l’effet est ténu car les raisons ne sont que très peu évoquées par les animateurs/journalistes, il faut rappeler que la connotation renforce l’image associée à l’information réelle (faire la grève) pour appuyer une certaine perception de celle-ci (râler ou se liguer).
Conclusion
Il faut prendre garde aux conclusions hâtives : les médias seraient-ils enclins à donner une perception négative des grèves et des grévistes ? Est-ce une attaque contre les cheminots et leurs syndicats ? Possible, mais peu probable car, comme évoqué ci-dessus, d’autres raisons amènent les journalistes à un tel traitement médiatique sans présupposer leurs intentions négatives à l’égard des syndicats. Je le rappelais plus haut, les médias vendent de l’information. Celle-ci doit donc être achetée/écoutée/vue pour rapporter un certain profit. Et par un maximum de personnes (la fameuse audience). La question se pose ainsi : comment faire en sorte qu’une information soit diffusée au plus au grand nombre ? En fournissant de longues et complexes explications au quidam qui patiente dans les embouteillages ? Certainement pas. En collant aux problèmes que tout un chacun rencontre en ce jour de galère ? Jackpot. Evidemment, en optant pour un traitement à court terme, on n’analyse ni les causes ni les mécanismes permettant de mieux comprendre la situation et les enjeux liés à la grève.
Cela m’amène à faire le pari (pas trop risqué) qu’une prochaine grève dans l’Education Nationale sera traitée de la même manière. Toutefois, les informations liées à la grève des taxis le même jour m’ont permis de mettre en lumière une constante dans les trois émissions : à chaque lancement, les raisons de la grève étaient systématiquement données, certes de façon tronquée et brève, mais néanmoins précisées. Les journalistes auraient-ils une perception différente du sort des taxis ? Sans doute, ceux-ci n’ayant pas encore une image aussi dégradée et négative que les cheminots, décrits depuis des années comme des privilégiés incapables d’accepter que l’on touche à leurs avantages.
Pour ma part, après six heures passées à écouter ces émissions, je n’avais entendu que six minutes d’explications assez complètes (lors de l’entrevue de Gilbert Garrel) et je n’ai vraiment compris le problème qu’après la consultation du dossier de la CGT cheminots, plutôt clair et complet. Bien entendu, les contre-arguments avancés sont discutables et la direction de SNCF ainsi que le gouvernement ont pu exposer ceux-ci dans divers journaux. D’autres sites Internet avaient également relayé certaines de ces informations mais force est de constater que les médias tels que la radio (et par continuité la télévision) n’ont fourni ce jour aucune information objective et complète malgré le temps consacré à « l’événement ». Ce que j’ai retenu en écoutant ces émissions ? Que la grève, c’est chiant.
Je ne prétends pas à une analyse exhaustive du traitement médiatique de la grève et je laisse le soin d’en faire autant avec le reste des émissions à toute personne intéressée par la poursuite de cette analyse.Tout complément sera donc le bienvenu.
Denis Caroti
————————
Références et bibliographie
– L’article de Blaise Magnin et Henri Maler sur le site d’Acrimed
– Autres articles et émissions traitant du même sujet :
- sur le site de la CNT
- Le Secret des sources sur France Culture
- Médiapart
- Le Monde
– Les Nouveaux Chiens de garde, Serge Halimi, Raisons d’agir, 2005.
– Les Nouveaux chiens de garde en DVD également par Gilles Balbastre et Yannick Kergoat, 2012.
– Les petits soldats du journalisme, François Ruffin, Les Arènes, 2003.
– La fabrication de l’information, les journalistes et l’idéologie de l’information, M.Benasayag et F. Aubenas, La Découverte, 2007.

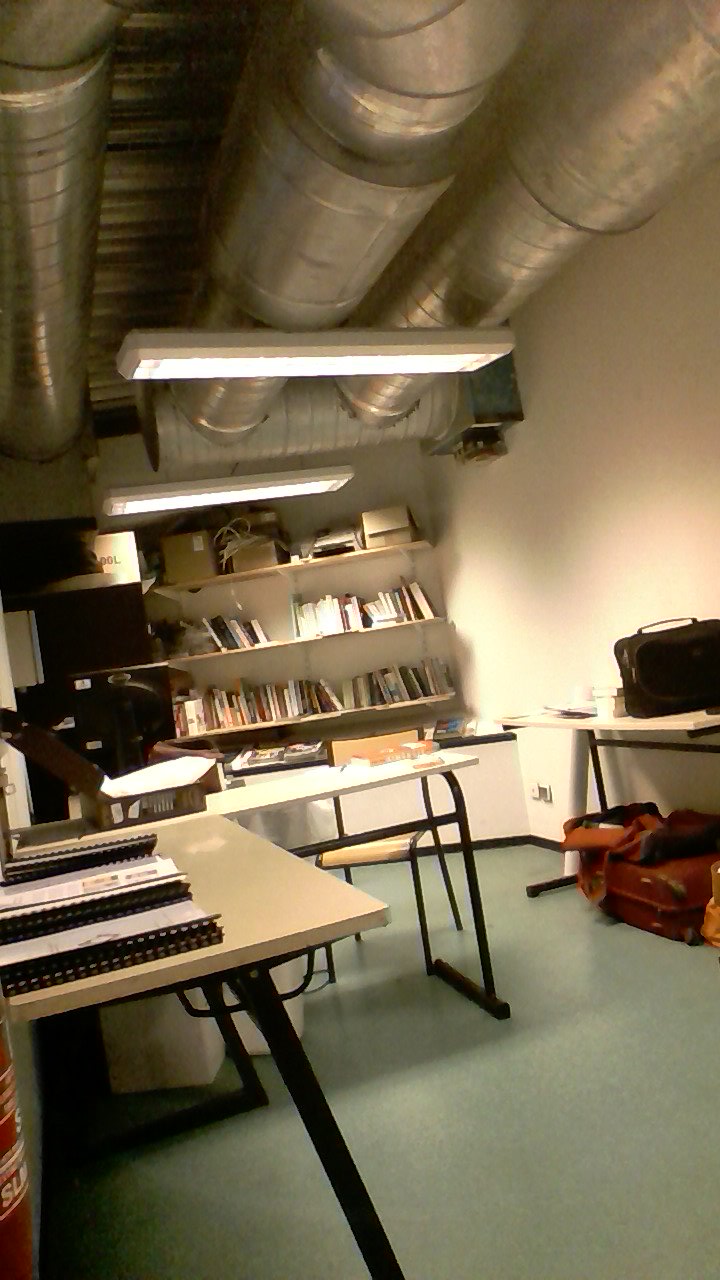
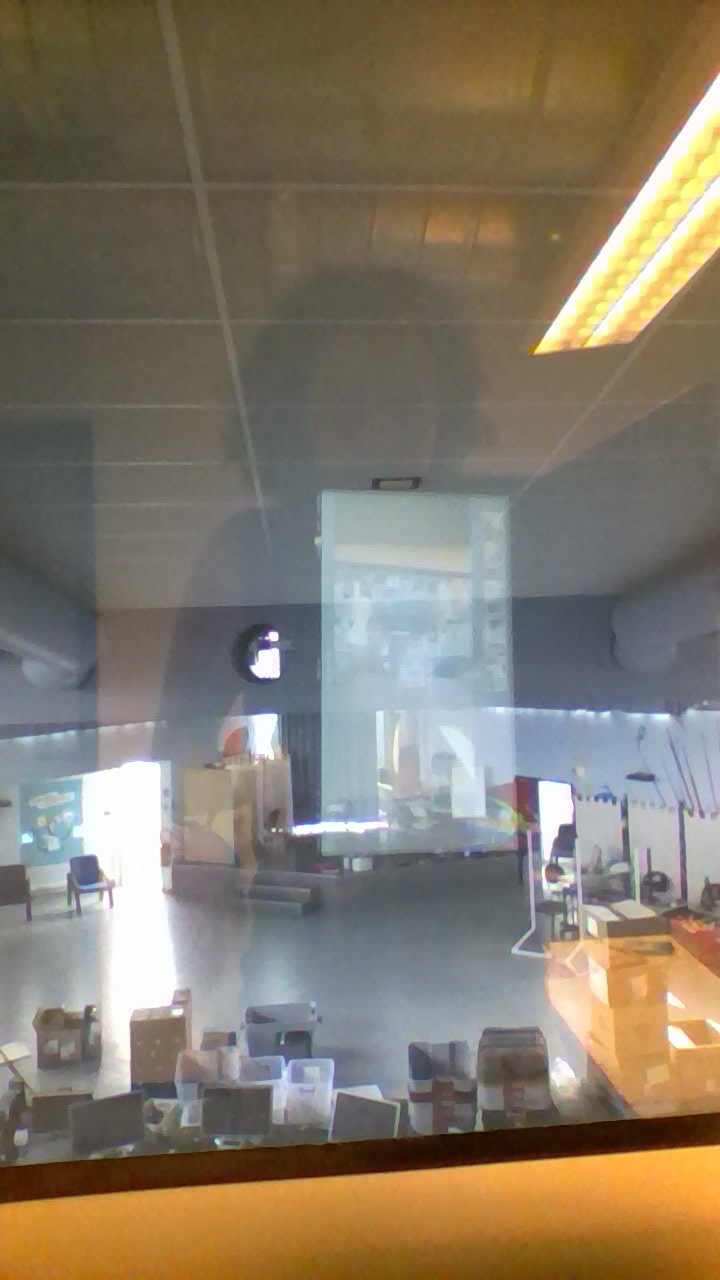

 Cet exercice faisait partie de l’examen de l’UE Zététique & autodéfense intellectuelle, niveau Licence, posé par Richard Monvoisin en mai 2014 à l’Université de Grenoble.
Cet exercice faisait partie de l’examen de l’UE Zététique & autodéfense intellectuelle, niveau Licence, posé par Richard Monvoisin en mai 2014 à l’Université de Grenoble.